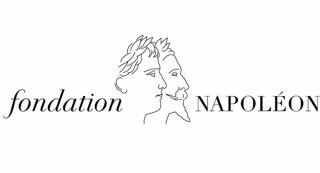Didier Dudal
(Adaptation d’un article paru dans le Bulletin du Centre de Généalogie des Côtes d’Armor)
J’ai sans doute tort de penser que l’histoire est multiple et changeante, qu’elle comprend une certaine dose de subjectivité et que chacun a droit à «son» histoire, sa façon de comprendre d’où il vient et ce qu’il est.
Un mystère que chacun élucide à sa manière, en fonction de l’actualité et de sa propre histoire.
Un grand nombre d’entre nous, n’ont-ils pas été attirés vers l’histoire, par les manuels des collèges, et par les romans?
Notre petite histoire nous fascine. Cette histoire locale que nous nous approprions lentement, non sans quelque amateurisme, nous donne l’occasion de revisiter l’Histoire de France à travers la petite histoire, à travers le Premier Empire, et les carrières militaires, maritimes, de quelques uns de nos ancêtres qui nous accueillent.
Cette petite histoire est-elle vraiment petite pour nous ?
Cette recherche d’ancêtres ayant servi dans les Armées, ayant servi dans les armées de Napoléon nous conduit généralement au Château de Vincennes, au S.H.AT (le Service Historique de l’Armée de Terre), dans les vingt kilomètres d’étagères, les archives anciennes du « Dépôt de la Guerre », au pavillon des Armes.
VOLONTAIRES ET CONSCRITS SOUS LA RÉVOLUTION ET L’EMPIRE
DES VOLONTAIRES AUX CONSCRITS
De 1792, année de la déclaration de guerre à l’Autriche, à 1799, année du coup d’État de Bonaparte, la France se trouva presque constamment en guerre contre l’ennemi : intérieur ou extérieur.
L’armée de l’ancien régime n’avait pas été dissoute, mais elle ne pouvait pas répondre aux besoins des dirigeants révolutionnaires : en 1791 et 1792, un tiers des officiers démissionnèrent ou émigrèrent. D’ailleurs, cette armée, recrutée localement dans le cadre de régiments qui portaient le nom des provinces, reflétait et aggravait l’inégalité de la société royale. Les hommes s’engageaient par désespoir, pour fuir la misère. Ils ne disposaient d’aucune liberté, d’aucun droit. La discipline était féroce. Tous les officiers étaient nobles et vendaient souvent leurs charges.
La Révolution commença par introduire des réformes essentielles. les châtiments corporels, cruels et humiliants, furent abolis; les grades furent attribués selon le mérite et non selon l’origine sociale. On supprima l’enrôlement forcé pratiqué par des sergents recruteurs sans scrupule. On abandonna le rattachement des régiments aux provinces dans le but de constituer une armée vraiment nationale.
Mais ces réformes pratiques ne suffisaient pas.
Les hommes politiques de la Révolution considéraient le service militaire comme un devoir. Pour eux, tout citoyen mâle était un soldat et tout soldat demeurait un citoyen. Mais il faudra plus de dix ans, à travers la Terreur, le Directoire et le Consulat pour descendre des principes à la réalité du service militaire obligatoire.
L’évolution se fit en trois périodes.
Les volontaires
On fit d’abord appel aux volontaires.
La première assemblée révolutionnaire, la Constituante, se borna à recruter 100.000 auxiliaires des régiments de ligne puis, en 1791, un nouveau contingent de volontaires.
Nombreux furent les jeunes Français qui répondirent à ces appels passionnés, alors même que le pays n’était pas en guerre. D’ailleurs, ils furent admirés et honorés, on leur promit la gloire et un rapide retour dans leurs foyers. Le décret du 28 décembre 1791 semble même organiser un service militaire à la carte: «Tous les citoyens admis dans les bataillons des gardes nationaux volontaires seront libres de se retirer après la fin de chaque campagne …. la campagne sera censée se terminer le premier décembre de chaque année».
Les assemblées suivantes, la Législative (1791-1792) et la Convention (1792-1795), tout en prônant le service militaire obligatoire, se bornèrent à lever des «volontaires». Mais, en créant des régiments de volontaires séparés des régiments de ligne et jouissant de faveurs refusées à ces derniers, la Révolution provoqua des jalousies et des dissensions. Pour y remédier, la loi du 21 février 1793 organisa «l’amalgame» en fusionnant deux bataillons de volontaires avec un régiment de troupes régulières pour former une nouvelle unité, la demi-brigade. Les différences de solde et de discipline furent abolies. Les officiers subalternes et les sous-officiers furent élus. Cette loi, bien que contestée et appliquée avec retard en raison de la guerre, fondit les armées révolutionnaires en une force efficace et victorieuse.
Mais la guerre apporta aussi son lot de souffrances, de blessures et de morts. Les appels de 1792 eurent moins de succès que ceux de 1791.
Les volontaires désignés
En 1793, les besoins en effectifs ne cessant d’augmenter, les «volontaires» furent quasiment désignés. Tout en continuant les discours enflammes prônant le volontariat, les deux recrutements de 1793 -«la levée des 300.000» de février et «la levée en masse» de l’automne- employèrent la contrainte. Chaque département se voyait fixer le nombre des «volontaires» qu’il devait fournir -et les départements se tournèrent vers les communes pour qu’elles apportent leurs volontaires désignés. Tout homme de 18 à 40 ans, célibataire ou veuf sans enfant, était en état permanent de «réquisition». On procéda au tirage au sort parmi eux – et il était impossible de se faire remplacer.
A l’échelle nationale, le recrutement de cette année fut gigantesque. Pratiquement, tous les jeunes de 18 à 22 ans prirent les armes. Seuls restèrent ceux qui étaient mariés ou chargés de famille.. On peut dire que les villages s’étaient vidés de ses jeunes célibataires.
Or, ces «volontaires» devaient rester cinq ans sous les armes.
En effet, on n’eut pas l’occasion de procéder à d’autres enrôlements systématiques au cours des années suivantes jusqu’à l’introduction de la conscription annuelle de 1799. Au moment du Coup d’État de brumaire, les «volontaires» de 1793, quand ils n’avaient pas été tués ou réformés pour blessures, constituaient toujours le gros des armées françaises – et parfois à des semaines de marche de leur village d’origine.
Ces « soldats de l’an II « , chantés par Victor Hugo, formèrent une armée expérimentée, relativement démocratique et mélangée, qui élisait ses officiers et dont les généraux, nommés sur des critères de loyauté politique au nouveau régime, souvent des hommes jeunes, révélèrent de grandes qualités. Ce fut l’armée de Hoche, de Bonaparte.
Mais les pertes et les désertions s’accumulaient. En 1797, l’armée de la République, qui avait compté un million d’hommes, était tombée à moins de 400 000. C’était insuffisant, alors que la guerre se rallumait partout en Europe.
Les conscrits
La loi préparée par le général Jourdan-Delbrel et votée le 19 thermidor an VI (5 septembre 1798) jeta les bases du service militaire obligatoire pour plus d’un siècle.

Tous les Français ayant 20 ans révolus devaient être inscrits ensemble c’est-à-dire conscrits -sur les tableaux de recrutement de l’armée. Tous les Français nés la même année formaient une «classe». Le service militaire s’imposait à eux, sauf dispense. Il durait cinq ans en temps de paix. Les hommes mariés étaient exemptés. Aucun Français ne pouvait exercer une fonction publique ou jouir de ses droits civiques s’il n’avait pas satisfait à ses obligations militaires.
Dès 1799, les communes et les départements dressèrent les tableaux de recrutement et des conseils de révision furent constitués. On assista chaque année au départ des conscrits «bons pour le service», à pied, sous les ordres d’un sous-officier. Il y eut des banquets, des bals, des discours… mais aussi des cœurs serrés et des larmes pathétiques.
En 1798, sur 202.000 conscrits, 143.000 furent déclarés aptes et seulement 93.000 partirent «au régiment ».
En définitive c’est près de 2,5 millions d’hommes, parmi la population européenne dont les trois quarts sont français qui sont mobilisés par Napoléon.
Les lenteurs administratives, la complaisance ou la corruption et les oppositions à ce nouveau recrutement expliquent cette faible efficacité.
Au printemps de 1799, le Directoire décida d’appeler 150.000 hommes désignés par tirage au sort. Peu à peu, le beau principe égalitaire fut mis à mal : les «tirés au sort» pouvaient se faire «remplacer» contre rémunération. Les pauvres mourraient pour les riches. Des révoltes éclatèrent. Puis, la même année, sous la pression des armées ennemies, une loi décida de réexaminer les exemptés de la levée précédente. Nouvelles révoltes. Mais les 400.000 recrues de 1799 permirent de vaincre les armées des monarchies.

Depuis 1791, les jeunes nés entre 1768 et 1775 ont été enrôlés dans les armées révolutionnaires :
– volontaires de 1791, puis de 1792,
– réquisitionnaires de 1793,
engagés volontaires de toutes sortes…..
Les contingents mobilisables
| Années | Conscription | dates | sur hommes nés en ….. | rappels éventuels en … | Rappels de conscriptions | Effectifs |
| 1798-1799 | an VII et VIII | 1799 | 1775 à 1779 | néant | ||
| 1800-1801 | an IX et X | 1801 | 1779 à 1781 | ans XIII et XIV | ||
| 1802-1803 | an XI et XII | 1803 | 1781 à 1783 | ans XIII et XIV |
90 000
(1802-1803) |
|
| 1804 | an XIII | 1804 | 1783 à 1784 | ans XIII et XIV | des ans IX et XIII | 65 000 |
| 1805 | an XIV | 1805 | 1784 à 1785 | an XIV | ||
| 1806 | 1806 | 8/1806 | 1785 à 1786 | 1808,1809,1812,1813 | 80 000 | |
| 1807 | 1807 | 1/1807 | 1787 | « idem » | 80 000 | |
| 1808 | 1808 | 4/1807 | 1788 | « idem » | 1806 à 1809 (9/1808) | |
| 1809 | 1809 | 1/1808 | 1789 | « idem » |
1810
(3/1809) |
275 000
(1808-1809) |
| 1810 | 1810 | 9/1808 | 1790 | 1812, 1813 | ||
| 1811 | 1811 | 5/1811 | 1791 | « idem » | 340 000 | |
| 1812 | 1812 | 12/1811 | 1792 | « idem » |
1807 à 1812
(3/1812) |
252 000 |
| 1813 | 1813 | 9/1812 | 1793 | 1813 |
1810 à 1812
(1/1813) |
857 000 |
| 1813 |
1808 à 1814
(10/1813) |
|||||
| 1813 |
an XI à 1814
(11/1813) |
|||||
| 1814 | 1814 | 1/1813 | 1793 à 1794 | « idem » | ||
|
1815 |
1815 |
2/1814 |
1794 à 1795 |
« idem » |
1815 et tous les anciens militaires.
4/1815 |
Les Archives
La série R permet de dresser les listes de conscription année par année.
De 1804 à 1814, les jeunes gens de 20 ans passent devant ce qui deviendra le conseil de révision. Les jeunes gens qui auront survécu aux maladies infantiles, épidémies, et autres accidents vont être répertoriés lors des opérations du tirage au sort.
Attention sous l’empire les conscriptions sont parfois mises en activités dans les 18 et 19ème années des conscrits.
La connaissance des individus s’étoffe alors d’avantage, dans la plupart des cas notamment par la mention de leurs caractéristiques physiques :
– Taille pour tous, forme du visage, du front, du nez, de la bouche, du menton, de la couleur des yeux, des cheveux et des signes particuliers éventuels. Apparaissent à ce moment des notions médicales pour les réformes, des éléments nouveaux :
– Notions sociales, placement en réserve, remplacement etc.
Ceux qui partiront vont être affectés et leurs dossiers seront en principe conservés aux archives militaires de Vincennes.
Il est ainsi possible, par exemple pour les années 1800-1806, de dresser un
RÉCAPITULATIF DES AFFECTATIONS MAJEURES PAR DÉPARTEMENTS
1800 -1806
Didier Dudal
Sur la base de recherches effectuées par Patrice THEBAUT de l’Association HEURTEBRISE
Note : La colonne [1812-1813] donne le numéro de cohorte nationale (1812).
| Régions | Départements (actuels) | Anciennement | N° du département | 1803-1808 | 1812-1813 |
| ALSACE | Bas-Rhin | 67 | 27e de ligne | 86 | |
| Haut-Rhin | 68 | 61e de ligne | 87 | ||
| AQUITAINE | Dordogne | 24 | 47e de ligne | 130 | |
| Gironde | 33 | 19e de ligne | 73 | ||
| Landes | 40 | 2e de ligne | 104 | ||
| Lot-et -Garonne | 47 | 2e léger | 131 | ||
| Pyrénées-atlantique | Basses-Pyrénées. | 64 | 24e de ligne | 104 | |
| AUVERGNE | Allier | 03 | 58e de ligne | 133 | |
| Cantal | 15 | 25e de ligne | 127 | ||
| Haute-Loire | 43 | 21e léger | 127 | ||
| Puy de dôme | 63 | 22e léger | 128 | ||
| BOURGOGNE | Côte D’Or | 21 | 92e de ligne | 123 | |
| Nièvre | 58 | 23e de ligne | 132 | ||
| Saône-et-Loire | 71 | 18e de ligne | 125 | ||
| Yonne | 89 | 30e de ligne | 126 | ||
| BRETAGNE | Côtes-d’Armor | Côtes-du-Nord | 22 | 60e de ligne | 140 |
| Finistère | 29 | 76e de ligne | 140 | ||
| Ille-et-Vilaine | 35 | 24e de ligne | 140 | ||
| Morbihan | 56 | 103e de ligne | 140 | ||
| CENTRE | Cher | 18 | 81e de ligne | 132 | |
| Eure-et-Loir | 28 | 15e de ligne | 77 | ||
| Indre | 36 | 95e de ligne | 134 | ||
| Indre-et-Loire | 37 | 90e de ligne | 135 | ||
| Loir-et-Cher | 41 | 105e de ligne | 135 | ||
| Loiret | 45 | 64e de ligne | 77 | ||
| CHAMPAGNE-ARDENNE | Ardennes | 08 | 59e, 104e de ligne | 81 | |
| Aube | 10 | 69e, 87e de ligne | 124 | ||
| Marne | 51 | 85e de ligne | 81, 82 | ||
| Haute-Marne | 52 | 14e de ligne | 124 | ||
| CORSE | Corse-du-Sud | Liamone (1) | 2A | — | — |
| Haute-Corse | Golo (2) | 2B | — | — | |
| FRANCHE-COMTE | Doubs | 25 | 106e de ligne | 88 | |
| Jura | 39 | 15e de ligne | 89 | ||
| Haute-Saône | 70 | 29e de ligne | 90 | ||
| Territoire de Belfort | (Formé en 1871)* | 90 | |||
| ÎLE-DE-FRANCE | Paris (Ville de) | Seine | 75 | 9e de ligne | 69 |
| Seine-et-Marne | 77 | 88e de ligne | 79 | ||
| Yvelines | Seine-et-Oise | 78 | 75e de ligne | 80 | |
| Essonne | 91 | ||||
| Hauts-de-Seine | 92 | ||||
| Seine-Saint-Denis | 93 | ||||
| Val-de-Marne | 94 | ||||
| Val-d’Oise | 95 | ||||
| LANGUEDOC-ROUSSILLON | Aude | 11 | 94e, 99e de ligne | 103 | |
| Gard | 30 | 7e de ligne | 99 | ||
| Hérault | 34 | 67e de ligne | 96 | ||
| Lozère | 48 | 30e léger | 98 | ||
| Pyrénées-Orientales | 66 | 23e de ligne | 103 | ||
| LIMOUSIN | Corrèze | 19 | 44e de ligne | 130 | |
| Creuse | 23 | 35e, 78e de ligne | 133 | ||
| Haute-Vienne | 87 | 16e léger | 134 | ||
| PAYS DE LA LOIRE | Loire-Atlantique | Loire-inférieure | 44 | 84e de ligne | 106 |
| Maine-et-Loire | 49 | 102e de ligne | 136 | ||
| Mayenne | 53 | 80e de ligne | 137 | ||
| Sarthe | 72 | 11e de ligne | 138 | ||
| Vendée | 85 | 56e de ligne | 105 | ||
| LORRAINE | Meurthe-et-Moselle | ( Créé en 1871 ) | 54 | — | — |
| Meuse | 55 | 55e de ligne | 82 | ||
| Moselle | 57 | 4e de ligne | 83 | ||
| Vosges | 88 | 9e léger | 85 | ||
| MIDI-PYRÉNÉES | Ariège | 09 | 93e de ligne | 101 | |
| Aveyron | 12 | 62e, 107e de ligne | 97 | ||
| Haute-Garonne | 31 | 20e de ligne | 100 | ||
| Gers | 32 | 70e de ligne | 102 | ||
| Lot | 46 | 12e léger | 131 | ||
| Hautes-Pyrenées | 65 | 12e1éger | 101 | ||
| Tarn | 81 | 10e léger | 99 | ||
| Tarn-et-Garonne | ( Créé en 1808 ) | 82 | — | — | |
| NORD-PAS-DE-CALAIS | Nord | 59 | 19e de ligne | 118-120 | |
| Pas-de-Calais | 62 | 34e de ligne | 122 | ||
| HAUTE-NORMANDIE | Eure | 27 | 33e, 103e de ligne | 116 | |
| Seine-Maritime | Seine-inférieure | 76 | 22e, 57e de ligne | 115 | |
| BASSE-NORMANDIE | Calvados | 14 | 28e de ligne | 112 | |
| Manche | 50 | 40e de ligne | 113 | ||
| Orne | 61 | 43e de ligne | 114 | ||
| PICARDIE | Aisne | 02 | 32e de ligne | 76 | |
| Oise | 60 | 43e de ligne | 78 | ||
| Somme | 80 | 39e de ligne | 117 | ||
| POITOU-CHARENTE | Charente | 16 | 68e, 95e de ligne | 129 | |
| Charente-Maritime | Charente-inférieure. | 17 | 42e, 77e de ligne | 105 | |
| Deux-Sèvres | 79 | 79e de ligne | 107 | ||
| Vienne | 86 | 97e de ligne | 107 | ||
| PROVENCE-ALPES CÔTE-D’AZUR |
Alpes-Haute-Provence | Basses-Alpes | 04 | 17e léger | 94 |
| Hautes-Alpes | 05 | 3e léger | 92 | ||
| Alpes-Maritimes | 06 | 1er léger | 94 | ||
| Bouches-du-Rhône | 13 | 37e, 60e de ligne | 74 | ||
| Var | 83 | 1er de ligne | 95 | ||
| Vaucluse | 84 | 52e de ligne | 94 | ||
| RHÔNE-ALPES | Ain | 01 | 101e de ligne | 88 | |
| Ardèche | 07 | 3e de ligne | 98 | ||
| Drôme | 26 | 74e de ligne | 92 | ||
| Isère | 38 | 30e de ligne | 91 | ||
| Loire | 42 | 4e léger | 72 | ||
| Rhône | 69 | 6e léger | 72 | ||
| Savoie | Mont-Blanc | 73 | 26e léger | 93 | |
| Haute-Savoie | Mont-Blanc | 74 | 26e léger | 93 | |
| 1795 Création du département | Meuse-Inférieure | 48e de ligne | — | ||
| 1797 Création des départements | Mont-Tonnerre | ||||
| Roer | |||||
| Sarre | |||||
| Rhin et Moselle | |||||
| * A reçu le statut de département en 1922. |
(1) En 1790 la Corse devint un département ; en 1793 création du département de Golo chef lieu Bastia.
(2) Idem ; en 1793 création du département de Liamone chef lieu Ajaccio.![]()
Didier Dudal
(Adaptation d’un article paru dans le Bulletin du Centre de Généalogie des Côtes d’Armor)