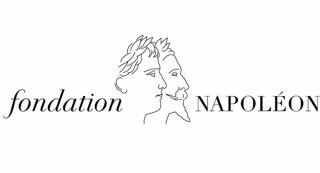[1]Général comte de Ségur. Histoire de Napoléon et de la Grande Armée pendant l’année 1812. Tome 1. Paris, 1825.
Le temps de délibérer était passé, et celui d’agir enfin venu. Le 9 mai 1812, Napoléon, jusque-là toujours triomphant, sort d’un palais où il ne devait plus rentrer que vaincu.
De Paris à Dresde, sa marche fut un triomphe continuel. C’était d’abord la France orientale qu’il avait à traverser; cette partie de l’empire lui était dévouée: bien différente de l’ouest et du sud, elle ne le connaissait que par des bienfaits et des triomphes. De nombreuses et brillantes armées que la fertile Allemagne attirait, et qui croyaient marcher à une gloire prompte et certaine, traversaient fièrement ces contrées, y répandaient de l’argent, en consommaient les produits. La guerre de ce côté avait toujours l’apparence de la justice.
Plus tard, quand nos heureux bulletins y arrivèrent, l’imagination, étonnée de se voir dépassée par la réalité, s’enflamma ; l’enthousiasme saisit ces peuples, comme aux temps d’Austerlitz et d’Iéna : on formait des groupes nombreux autour des courriers, on les écoutait avec ivresse, et, transporté de joie, l’on ne se séparait qu’aux cris de « Vive l’empereur ! Vive notre brave armée! »
On sait d’ailleurs que de tout temps, cette partie de la France fut belliqueuse. Elle est frontière: on y est élevé au bruit des armes, et les armes y sont en honneur. On y disait que cette guerre devait affranchir la Pologne, tant aimée de la France; que les barbares d’Asie, dont on menaçait l’Europe, allaient être repoussés dans leurs déserts ; que Napoléon rapporterait encore une fois tous les fruits de la victoire.
Ne seraient-ce pas les départements de l’est qui les recueilleraient ? Jusque-là n’avaient-ils pas dû leurs richesses à la guerre, qui faisait passer par leurs mains tout le commerce de la France avec l’Europe ! En effet, bloqué partout ailleurs, l’empire ne respirait et ne s’alimentait que par ses provinces de l’est.
Depuis dix ans, leurs routes étaient couvertes de voyageurs de tous les rangs, qui venaient admirer la grande nation, sa capitale chaque jour embellie, les chefs-d’œuvre de tous les arts et de tous les siècles, que la victoire y avait rassemblés; et surtout cet homme extraordinaire, prêt-à-porter la gloire nationale au-delà de toutes les gloires connues.
Satisfaits dans leurs intérêts, comblés dans leur amour-propre, les peuples de l’est de la France devaient donc tout à la victoire. Ils ne se montrèrent point ingrats ; aussi accompagnèrent-ils l’empereur de tous leurs vœux : ce fut partout des acclamations et des arcs de triomphe, partout un même empressement.
En Allemagne, on trouva moins d’affection, mais plus d’hommages peut-être. Vaincus et soumis, les Allemands, soit amour-propre, soit penchant pour le merveilleux, étaient tentés de voir dans Napoléon un être surnaturel. Étonnés, comme hors d’eux-mêmes, et emportés par le mouvement universel, ces bons peuples s’efforçaient d’être de bonne foi ce qu’il fallait paraître.
Ils vinrent border la longue route que suivait l’empereur. Leurs princes quittèrent leurs capitales et remplirent les villes où devait s’arrêter quelques instants cet arbitre de leurs destins. L’impératrice et une cour nombreuse suivaient Napoléon ; il marchait aux terribles chances d’une guerre lointaine et décisive, comme on en revient vainqueur et triomphant. Ce n’était pas ainsi que jadis il avait coutume de se présenter au combat.
Il avait souhaité que l’empereur d’Autriche, plusieurs rois, et une foule de princes, vinssent à Dresde sur son passage ; son désir fut satisfait ; tous accoururent: les uns guidés par l’espoir, d’autres poussés par la crainte ; pour lui, son motif fut de s’assurer de son pouvoir, de le montrer, et d’en jouir.
Dans ce rapprochement avec l’antique maison d’Autriche, son ambition se plut à montrer à l’Allemagne une réunion de famille. Il pensa que cette assemblée brillante de souverains contrasterait avec l’isolement du prince russe ; qu’il s’effraierait peut-être de cet abandon général. Enfin, cette réunion de monarques coalisés semblait déclarer que la guerre de Russie était européenne.
Là, il était au centre de l’Allemagne, lui montrant son épouse, la fille des Césars, assise à ses côtés. Des peuples entiers s’étaient déplacés pour se précipiter sur ses pas; riches et pauvres, nobles comme plébéiens, amis et ennemis, tous accouraient. On voyait leur foule curieuse, attentive, se presser dans les rues, sur les routes, dans les places publiques ; ils passaient des jours, des nuits entières, les yeux fixés sur la porte et sur les fenêtres de son palais.
Ce n’est point sa couronne, son rang, le luxe de sa cour, c’est lui seul qu’ils viennent contempler; c’est un souvenir de ses traits qu’ils cherchent à recueillir : ils veulent pouvoir dire à leurs compatriotes, à leurs descendants moins heureux, qu’ils ont vu Napoléon.
Sur les théâtres, des poètes s’abaissèrent jusqu’à le diviniser ; ainsi des peuples entiers étaient ses flatteurs.
Dans ces hommages d’admiration, il y eut peu de différence entre les rois et leurs peuples; on n’attendit pas même à s’imiter, ce fut un accord unanime. Pourtant les sentiments intérieurs n’étaient pas les mêmes.
Dans cette importante entrevue, nous étions attentifs à considérer ce que ces princes y apporteraient d’empressement, et notre chef de fierté. Nous espérions en sa prudence, ou que, blasé sur tant de puissance, il dédaignerait d’en abuser; mais celui qui, inférieur encore, n’avait parlé qu’en ordonnant, même à ses chefs, aujourd’hui vainqueur et maître de tous, pourrait-il se plier à des égards suivis et minutieux ?
Cependant il se montra modéré, et chercha même à plaire; mais ce fut avec effort, en laissant apercevoir la fatigue qu’il en éprouvait. Chez ces princes, il avait plutôt l’air de les recevoir que d’en être reçu.
De leur côté, on eût dit que, connaissant sa fierté, et n’espérant plus le vaincre que par lui-même, ces monarques et leurs peuples ne s’abaissaient tant autour de lui, que pour accroître disproportionnément son élévation et l’en éblouir. Dans leurs réunions, leur attitude, leurs paroles, jusqu’au son de leur voix, attestaient son ascendant sur eux.
Tous étaient là pour lui seul ! Ils discutaient à peine, toujours prêts à reconnaître sa supériorité, que lui ne sentait déjà que trop bien. Un suzerain n’eût pas beaucoup plus exigé de ses vassaux.
Son lever offrait un spectacle encore plus remarquable ! Des princes souverains y vinrent attendre l’audience du vainqueur de l’Europe : ils étaient tellement mêlés à ses officiers, que souvent ceux-ci s’avertissaient de prendre garde, et de ne point froisser involontairement ces nouveaux courtisans, confondus avec eux.
Ainsi la présence de Napoléon faisait disparaître les différences ; il était autant leur chef que le nôtre. Cette dépendance commune semblait tout niveler autour de lui. Peut-être alors, l’orgueil militaire mal contenu, de plusieurs généraux français, choqua ces princes : on se croyait élevé jusqu’à eux ; car enfin quels que soient la noblesse et le rang du vaincu, le vainqueur est son égal.
Cependant, les plus sages d’entre nous s’effrayaient: ils disaient, mais sourdement, qu’il fallait se croire surnaturel pour tout dénaturer et déplacer ainsi, sans craindre d’être entraîné soi-même dans ce bouleversement universel. Ils voyaient ces monarques quitter le palais de Napoléon, l’œil et le sein gonflé des plus amers ressentiments. Ils croyaient les entendre la nuit, seuls avec leurs ministres, faisant sortir de leurs cœurs cette multitude de chagrins qu’ils avaient dévorés.
Tout avait aigri leur douleur ! Qu’elle était importune cette foule qu’il leur avait fallu traverser, pour parvenir à la porte de leur superbe dominateur; et cependant, la leur restait déserte; car tout, même leurs peuples, semblait les trahir. En proclamant son bonheur, ne voyait-on pas qu’on insultait à leur infortune ?
Ils étaient donc venus à Dresde pour relever l’éclat du triomphe de Napoléon; car c’était d’eux qu’il triomphait ainsi: chaque cri d’admiration pour lui, étant un cri de reproche contre eux; sa grandeur étant leur abaissement ; ses victoires, leurs défaites.
Ils répandaient sans doute ainsi leur amertume, et chaque jour la haine se creusait dans leur sein de plus profondes demeures. On vit d’abord un prince se soustraire à cette pénible position par un départ précipité. L’impératrice d’Autriche, dont le général Bonaparte avait dépossédé les aïeux en Italie, se distinguait par son aversion, qu’elle déguisait vainement : elle lui échappait par de premiers mouvements que saisissait Napoléon, et qu’il domptait en souriant; mais elle employait son esprit et sa grâce à pénétrer doucement dans les cœurs pour y semer sa haine.

L’impératrice de France augmenta involontairement cette funeste disposition. On la vit effacer sa belle-mère par l’éclat de sa parure: si Napoléon exigeait plus de réserve, elle résistait, pleurait même, et l’empereur cédait, soit attendrissement, fatigue, ou distraction. On assure encore que, malgré son origine, il échappa à cette princesse de mortifier l’amour-propre allemand, par des comparaisons peu mesurées, entre son ancienne et sa nouvelle patrie. Napoléon l’en grondait, mais doucement; ce patriotisme qu’il avait inspiré, lui plaisait; il croyait réparer ces imprudences par des présents.
Cette réunion ne put donc que froisser beaucoup de sentiments. Plusieurs amours-propres en sortirent blessés. Toutefois Napoléon, s’étant efforcé de plaire, pensa les avoir satisfaits : en attendant à Dresde le résultat des marches de son armée, dont les nombreuses colonnes traversaient encore les terres des alliés, il s’occupa donc surtout de sa politique.
Le général Lauriston, ambassadeur de France à Pétersbourg, reçut l’ordre de demander à l’empereur russe, qu’il l’autorisât à venir lui communiquer à Vilna des propositions définitives.
Le général Narbonne, aide-de-camp de Napoléon, partit pour le quartier-impérial d’Alexandre, afin d’assurer ce prince des dispositions pacifiques de la France, et pour l’attirer, dit-on, à Dresde.
L’archevêque de Malines [2]Il sagit alors de Dominique Frédéric Dufour de Pradt ( – ), fut envoyé pour diriger les élans du patriotisme polonais. Le roi de Saxe s’attendait à perdre le grand-duché; il fut flatté de l’espoir d’une indemnité plus solide.
Cependant, dès les premiers jours, on s’était étonné de n’avoir point vu le roi de Prusse grossir la cour impériale; mais bientôt on apprit qu’elle lui était comme interdite. Ce prince s’effraya d’autant plus qu’il avait moins de torts. Sa présence devait embarrasser.
Toutefois, encouragé par Narbonne, il se décide à venir. On annonce son arrivée à l’empereur : celui-ci irrité, refuse d’abord de le recevoir : « Que lui veut ce prince ! N’était-ce pas assez de l’importunité de ses lettres et de ses réclamations continuelles ! Pourquoi vient-il encore le persécuter de sa présence ! Qu’a-t-il besoin de lui ! »

Mais Duroc insiste; il rappelle le besoin que Napoléon a de la Prusse contre la Russie, et les portes de l’empereur s’ouvrent au monarque. Il fut reçu avec les égards que l’on devait à son rang suprême. On accepta les nouvelles assurances de son dévouement, dont il donna des preuves multipliées.
On dit qu’alors on fit espérer à ce monarque la possession des provinces russes allemandes, que ses troupes devaient être chargées d’envahir. On assure même qu’après leur conquête, il en demanda l’investiture à Napoléon. On a dit encore, mais vaguement, que Napoléon laissa le prince royal de Prusse prétendre à la main de l’une de ses nièces. C’était là le prix des services que lui rendrait la Prusse dans cette nouvelle guerre. Il allait, disait-il, l’essayer.
Ainsi Frédéric, devenu l’allié de Napoléon, pourrait conserver une couronne affaiblie, mais les preuves manquent pour affirmer que cette union séduisit le roi de Prusse, comme l’espoir d’une alliance pareille avait séduit le prince d’Espagne.
Telle était alors la résignation des souverains à la puissance de Napoléon. Ceci est un exemple de l’empire de la nécessité sur tous, et montre jusqu’où peut conduire, chez les princes, comme chez les particuliers, l’espoir d’acquérir et la crainte de perdre.

Cependant, Napoléon attendait encore le résultat des négociations de Lauriston et du général Narbonne. Il espérait vaincre Alexandre par le seul aspect de son armée réunie, et surtout par l’éclat menaçant de son séjour à Dresde.
À Posen, quelques jours après, lui-même en convint, quand il répondit au général Dessoles : « La réunion de Dresde n’ayant pas déterminé Alexandre à la paix, il ne faut plus l’attendre que de la guerre.»
Ce jour-là, il ne parla que de ses anciennes victoires. Il semblait que, doutant de l’avenir, il se retranchât dans le passé, et qu’il eût besoin de s’armer de tous ses plus glorieux souvenirs contre un grand péril. En effet, alors comme depuis, il sentit le besoin de se faire illusion sur la faiblesse prétendue du caractère de son rival. Aux approches d’une si grande invasion, il hésitait à l’envisager comme certaine; car il n’avait plus la conscience de son infaillibilité, ni cette assurance guerrière que donnent la force et le feu de la jeunesse, ni ce sentiment du succès qui l’assure.
Au reste, ces pourparlers étaient, non seulement une tentative de paix, mais encore une ruse de guerre. Par eux, il espérait rendre les Russes, ou assez négligents pour se laisser surprendre dispersés, ou assez présomptueux, s’ils étaient réunis, pour oser l’attendre. Dans l’un ou l’autre cas, la guerre se serait trouvée terminée par un coup de main, ou par une victoire.
Mais Lauriston ne fut pas reçu. Pour Narbonne, quand il revint,
« il avait, dit-il, trouvé les Russes sans abattement et sans jactance. De tout ce que leur empereur lui avait répondu, il résultait qu’on préférait la guerre à une paix honteuse; qu’on se garderait bien de s’exposer à une bataille contre un adversaire trop redoutable; qu’enfin, on saurait se résoudre à tous les sacrifices, pour traîner la guerre en longueur et rebuter Napoléon. »
Cette réponse, qui arrivait à l’empereur au milieu du plus grand éclat de sa gloire, fut dédaignée. S’il faut tout dire, j’ajouterai qu’un grand seigneur russe avait contribué à l’abuser : soit erreur ou feinte, ce Moscovite avait su lui persuader que son souverain se rebutait devant les difficultés, et se laissait facilement abattre par les revers. Malheureusement le souvenir des complaisances d’Alexandre à Tilsitt et à Erfurt, confirma l’empereur de France dans cette fausse opinion.
Il resta jusqu’au 29 mai à Dresde, fier de ces hommages qu’il savait apprécier ; montrant à l’Europe les princes et les rois, issus des plus antiques familles de l’Allemagne, formant une cour nombreuse à un prince né de lui seul. Il semblait se plaire à multiplier les effets de ces grands jeux du sort, comme pour en entourer et rendre plus naturel celui qui l’avait placé sur le trône, et pour y accoutumer ainsi les autres et lui-même. [3]Napoléon fera une halte à Dresde le 14 décembre 1812, lors de son retour de la Russie
References[+]