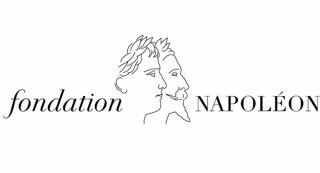Sainte-Hélène – Bertrand – Avril 1818
Avril 1818
Le Grand Maréchal envoie chercher M. Gorrequer et lui remet trois états : l’un relatif à l’arriéré des comptes de M. Cole, l’autre pour la répartition des fonds et le troisième pour les dépenses mensuelles des g derniers mois.
Le major lui remet une lettre d’un libraire (de Londres) qui offre le Tableau du Baptême du Roi de Rome avec un papier signé de M. Goulburn. Le major prétend que la répartition mensuelle (des fonds) est une bonne chose. Sur les 10.000 francs, le Grand Maréchal observe qu’on lui remet seulement les 3.000 francs de cette année et qu’on lui paye les 7.000 de l’arriéré sur mandat.
Le Grand Maréchal dîne avec l’Empereur.
L’Empereur dicte de nouveau la bataille de Ligny. Dîner avec l’Empereur.
Le docteur Baxter a dit au docteur (O’Meara) que Gourgaud avait montré son Journal de 3 ans; qu’il désirait que l’Empereur n’en voulût pas au Gouverneur; que c’était un parti pris d’être ainsi avec tout gouverneur; qu’on l’enverrait en Angleterre que ce serait la même chose.
Le général Montholon rencontre le Russe qui lui dit de Gourgaud tout ce qu’il a su : qu’il a fait de l’effet pendant quatre jours, qu’ensuite il a eu le mépris de tout le monde; qu’il ferait de l’effet à Londres en arrivant; que nous avons beaucoup d’amis et beaucoup d’ennemis; qu’il a reçu une lettre de Paris, d’un ingénieur qui dit que la cause des émigrés devient tous les jours plus mauvaise, que les révolutionnaires sont partout en place et que bientôt ils seront en possession de tout.
Hortense (Bertrand) s’exprime bien. Elle est décidée et donnera de la tablature si on n’y prend pas garde. Il faut l’élever avec soin. Qu’elle ne lise jamais de romans. C’est l’éducation la plus fausse et la plus propre à donner des idées fausses.
L’amour est un sentiment de la société, ce n’est pas celui de la nature. La nature rapproche les hommes des femmes en général, non d’une en particulier. L’amour est tel qu’aucune femme ne tente quand on en aime une et ce n’est pas là la nature, c’est une vertu ou un sentiment de société.
L’impératrice Marie-Louise avait bien raison; jamais elle ne voulait lire de romans. Je n’ai pu lui en faire lire, quoique je l’eusse désiré. Elle ne mentait jamais, ne m’a jamais donné de chagrins. Peut-être était-elle trop réservée. D’ailleurs, c’était la nature même. La première nuit elle disait : encore ! Depuis, lorsque, par la divination de la femme ou parce que l’esprit vient naturellement aux femmes, elle a su mesurer la valeur de ce qu’elle disait alors, elle s’en est défendu. Elle rougissait si je lui en parlais, m’affirmait n’avoir jamais dit cela. Elle aimait bien au reste avec ses seins ou de quelque manière tenter d’éveiller mes sens.
Le roi Murat était, à ce qu’il paraît, un homme prodigue (en amour). Il affolait la Reine en venant, la nuit, à l’heure où il était agité de quelque besoin pressant, et il n’y avait pas moyen de reculer. Après les premières enfilades, c’était pour elle un vrai supplice et qui lui inspirait du dégoût. Murat était sans conduite et par cette raison je ne voulais pas que Caroline l’épousât. Je le lui ai dit plusieurs fois : vous verrez un jour ce que c’est que de coucher avec un homme sans conduite, lorsque, sans chemise, vous vous trouverez seule avec lui et que l’homme sera à nu. Elle a reconnu la sagesse de ce conseil depuis. C’est, je crois, un mauvais homme : il s’est conduit de manière à le prouver, lorsque je réfléchis avec quelle bassesse il me flattait et m’a ensuite trahi (…).
Comment Rousseau a-t-il pu faire Héloïse? décrier la religion, prêcher partout l’amour ? Comment des gens de sens peuvent-ils diriger les sentiments du public de cette façon et créer l’opinion, cela ne se comprend pas. Sa Julie est un mauvais livre, détestable, ainsi que l’ode de Parny, ce n’est fait que pour les libertins. Et les femmes ne doivent pas le lire, au lieu que ses autres ouvrages sont destinés à orner les bibliothèques et à être lus par tout le monde.
L’Empereur dicte de nouveau la bataille de Ligny. Toute la semaine, le Grand Maréchal dîne avec l’Empereur. L’Empereur dîne au salon. Mme Bertrand n’y peut venir. Les Commissaires, Mme Sturmer et le marquis (de Mont- chenu) viennent à l’intérieur de Longwood. C’est la première fois que le marquis y vient. C’est Sturmer qui a déterminé ces messieurs à venir là.
Le Gouverneur a envoyé, la veille, les Lettres du Cap à M. Sturmer, celui-ci en ayant parlé d’après l’indication du docteur. Sturmer dit à Montchenu que c’est un ouvrage très bien fait, qui explique tout et qui lui a fait une grande impression.
Les affaires ne sont pas assises ni en France ni en Allemagne, où personne ne discute et n’a d’arguments. Notre affaire n’est pas désespérée.
Le Grand Maréchal demande au Russe s’il lui remettra une lettre cachetée de l’Empereur Napoléon pour l’Empereur son maître, s’il se chargerait de la faire remettre en mains propres. Celui-ci est extrêmement frappé de cette proposition. Ses instructions ne lui disent rien de cela. Il a ordre de n’éviter aucune occasion de voir les personnes de Longwood, mais il n’a encore reçu aucune réponse de son gouvernement. Il envoie toutes ses dépêches par lord Bathurst. Jusqu’à présent, il ne paraît pas qu’on ait rien ouvert, car, quoiqu’il écrit les choses les plus fortes contre le Gouverneur, on ne lui a rien dit. Le Grand Maréchal lui dit de réfléchir. Il donnera réponse jeudi, et, avant de prendre congé, il prie le Grand Maréchal de n’être pas fâché contre lui s’il ne lui a pas donné de réponse sur-le-champ.
Même question à M. Sturmer qui dit que, s’il part, il n’aura pas de difficulté; qu’il envoie toutes ses dépêches par lord Bathurst, qu’il n’écrit pas en chiffre, parce qu’on lui a dit que cela pourrait donner de l’inquiétude ; que depuis qu’il est ici il n’a eu qu’une occasion d’écrire sûrement, c’était par le botaniste (Welle). Il réfléchira et verra. Il dit deux mots au Grand Maréchal du général Gourgaud qui a dit au Gouverneur que je n’avais pu lui remettre de fonds quand il refusait ceux de l’Empereur.
Le Grand Maréchal dîne avec l’Empereur, qui dicte la fin de la bataille de Ligny : la position des armées dans la nuit du 17 au 18.
« La réponse de Sturmer me paraît meilleure que celle du Russe. Dans le fond, il doit y avoir plus d’affection de la part d’un beau-père. Il y a l’Impératrice (Marie-Louise) et le Roi de Rome qui doivent l’intéresser. Au lieu que la Russie n’a aucun intérêt de famille ; même s’il y avait eu alliance (avec elle), il n’y en aurait plus, car il est bien certain que l’empereur Alexandre a traité dans l’assurance de me perdre. Or qu’attendre du signataire du Traité de Tilsitt ?
A Tilsitt, pour faire ma cour à l’empereur Alexandre, je traitai bien ceux qui l’approchaient, et notamment le général Bennigsen. Alexandre me pria de ne pas le traiter si bien, attendu que tout ce que je faisais avait une grande influence et qu’il ne voulait pas en donner à un homme qui avait mis son talon sur la figure de son père (Paul Ier). La politique l’obligeait à dissimuler. Cependant, aujourd’hui ce même général Bennigsen commande l’armée contre les Turcs. Aujourd’hui, ce n’est plus la politique, il est assez puissant pour s’en passer.
A Erfurt, ce fut l’empereur Alexandre qui, le premier, me proposa sa sœur. Je répondis que j’étais marié, que le divorce n’était pas fait, que j’aimais ma femme; d’ailleurs que cela ne se commandait pas. »
L’Empereur visite Mme Bertrand qui lui dit que le marquis (de Montchenu) l’a beaucoup engagée à aller à Plantation House ; que Mme Sturmer reçoit beaucoup de lettres de sa mère, entre autres une lettre de cent pages. L’Empereur conclut de là :
1° Que le gouverneur paraît avoir envoyé le marquis pour avoir une visite de Mme Bertrand, que l’on croit toujours désireuse de se raccommoder, ou que, peut-être, il veut faire un article de gazette pour lui faire croire que ses trois ans expirent au mois d’octobre, que sa conduite ne l’a mené à rien, qu’il va perdre sa place.
2° Que la correspondance de Mme Sturmer donne beaucoup de précisions, à ce que dit son mari, sur les affaires de France.
Le major Gorrequer, M. Cole et M. Ibbetson viennent chez le Grand Maréchal. Le livre de M. Cole est d’accord avec celui remis par le Grand Maréchal. Il arrêtera et clora définitivement les comptes lorsqu’il aura l’avis de payement des lettres de change; mais le Gouverneur ne veut plus sur l’état mensuel, que 2.400 francs pour les dépenses de la Maison. Pour le supplément, il faudra, à chaque besoin, l’adresser au Gouverneur, de même sur l’état de l’arriéré de la Maison, il ne veut rien payer qu’on ne lui justifie les dépenses. Le Grand Maréchal dit que le Gouverneur peut, comme bon lui semble, réduire les dépenses de son gouvernement, qu’il ne fait à ce sujet aucune observation, mais que l’Empereur doit, au moins, pouvoir acheter ce qui peut lui rendre la vie un peu plus supportable sur cet affreux rocher; qu’il ne dépense que 3.400 francs parce qu’il ne peut acheter davantage, mais que certainement, s’il pouvait acheter des farines de bonne qualité, il le ferait; que depuis un an l’Empereur ne peut manger de pain, qu’il a assez du biscuit d’armée qui est trop sec, que l’eau est de la plus mauvaise qualité, et que si M. Ibbetson peut procurer de bonne eau et de bon pain, il aura beaucoup fait.
M. Gorrequer a apporté de petits bons, avec lesquels on prendra chez M. Ibbetson du pain, des vivres. Le Grand Maréchal dit qu’il est impossible de s’adresser au Gouverneur toutes les fois que nous aurons besoin d’acheter, qu’il faut trouver un autre moyen, qu’il fallait payer chez les marchands ce que l’on prenait.
Informé de cette conversation, l’Empereur dit :
Il faut faire venir Gorrequer, lui demander une réponse par écrit, afin que je fasse ma protestation et que je puisse faire connaître à l’Europe avec quel manque d’égards et quelle indécence je suis traité. Mille francs de plus ou de moins par mois ne sont pas un objet d’inquiétude pour le Gouverneur. Il n’y a évidemment là que l’intention de tourmenter. Le devoir du Gouvernement anglais et les traités l’obligent à payer toutes les dépenses. Il doit le faire et s’il ne le fait pas, on a besoin de 10.000 francs par mois, avec lesquels on peut, comme on l’a fait jusqu’à présent, franchir le passage. Ainsi il y a eu jusqu’à présent une mensualité dont parle le Gouverneur. Je me servirai de l’intermédiaire d’un banquier, mais c’est une honte de plus que la trésorerie d’Angleterre se charge d’escompter les lettres de change. M. le Gouverneur entend mal les intérêts comme l’honneur de son pays.
Le major Gorrequer ayant demandé une réponse pour le portrait du Roi de Rome, l’Empereur réplique qu’il ne sait comment allier cela avec la défense de lui remettre les portraits qui se vendent sur les quais de Londres. Il dicte, le soir, une note.
Mme Bertrand fait une fausse couche. M. Gorrequer vient. Le Grand Maréchal dit que l’Empereur a vu avec une grande peine qu’on ait ôté la fourniture à la maison Balcombe qui avait de nombreuses relations dans l’île, tandis que M. Ibbetson ne pouvait se tenir à sa disposition ; que l’Empereur désirait qu’on lui laissât son banquier, qu’à son défaut on désirait une maison bien faite pour le remplacer; que si le gouvernement anglais voulait faire toutes les dépenses de Longwood — comme cela était le devoir du gouvernement anglais et comme il y était obligé par le traité — il était juste que son contrôle de Gouverneur intervînt, mais que si l’Empereur faisait ses dépenses avec ses fonds, il était naturel qu’il eût son banquier.
« Quant au refus du Gouverneur d’allouer 3.400 francs demandés par ma Maison, je ne veux rien si on ne m’accorde pas ce que je demande. Le Gouverneur peut économiser sur les fournitures comme il l’entend, on ne se mêle pas de cela, mais je suis libre de dépenser mon argent comme je l’entends. Je veux qu’on paye la répartition telle qu’elle a été donnée, je ne veux m’engager à aucun compte, à aucune autre formalité que celle jusqu’à ce jour depuis trois ans. Si le Gouverneur refuse d’allouer cette somme, je ne veux rien ni pour moi, ni pour mes domestiques, ni pour mes officiers. Je ne changerai pas de chemise si on m’y réduit. Je me suis confiné dans ma chambre pour me soustraire aux vexations du Gouverneur, qui tous les jours en invente de nouvelles. Il a déjà attaqué ma santé, il veut achever son œuvre. Je suis résigné à me passer de tout. L’Europe aura connaissance qu’on me conteste le droit de dépenser pour ma Maison 1.000 francs de plus ou de moins. »
Quant à l’arriéré pour lequel le major Gorrequer a demandé un état des dépenses, le Grand Maréchal remet une note du maître d’hôtel qui dit que, dans les premiers temps, on a suivi les errements de l’amiral : on n’a fait que peu d’achats ; depuis le mois d’octobre, on a dépensé 6.000 francs par mois, dans un autre 5.000, puis aujourd’hui 3 ou 4.000.
Quant aux petits bons que M. le Gouverneur a envoyés, je ne sais ce qu’il veut dire avec ces petits bons comme on en remet aux collégiens et aux écoliers pour avoir du beurre ou des cerises.
En conséquence, l’Empereur a rendu ces petits bons et a remis une note qui comprend le résumé de sa conversation.
M. Gorrequer a dit que le Gouverneur n’entendait pas empêcher Napoléon de dépenser son argent, mais seulement qu’il en justifiât l’emploi. Il a remis une note du Gouverneur expliquant cela. Le Grand Maréchal, après avoir parcouru la note, a dit que cela était inutile, puisqu’on partait d’un principe que l’Empereur ne voulait pas admettre, que le Gouverneur ne voulant allouer que 2.400 francs, la décision là-dessus était positivement énoncée par la lettre qu’il a faite tout aussitôt. M. Gorrequer a demandé qu’on indiquât seulement à M. Ibbetson l’emploi sommaire des fonds.
Le Grand Maréchal a répliqué qu’il ne voulait remplir aucune formule. M. Gorrequer a dit que le lendemain, il enverrait l’argent des domestiques. Le Grand Maréchal a répondu que cela était inutile si on ne portait pas tout le reste; qu’il ne recevrait rien. Il a ajouté qu’il était entré, le matin, dans la chambre à coucher de l’Empereur avant qu’il fût levé, qu’elle sentait l’humidité et le moisi; que tous ces tracas achèveraient bientôt celui qu’on devrait soigner par tant de moyens. Il a ajouté que le Gouverneur avait cru faire merveille en ôtant à l’Empereur son banquier et en lui substituant un agent de la Trésorerie, mais qu’en cela il avait mal vu, puisque le gouvernement anglais ne voulait pas faire la dépense (de Longwood) comme c’était son devoir, il avait du moins consenti à laisser l’Empereur escompter ses fonds par un banquier, et aujourd’hui la Trésorerie se fait l’intermédiaire de cet escompte. C’est une honte de plus pour le gouvernement anglais. Le Gouverneur entend mal les intérêts comme l’honneur de son gouvernement. Il en sera probablement blâmé.
M. Ibbetson vient et porte tous les fonds relatifs aux deux derniers mois arriérés. Le Grand Maréchal lui remet une lettre de change pour compléter les fonds.
Conversation avec l’Empereur qui sera rapportée un peu plus bas sur Fouché, Cambacérès et autres personnes.
L’Empereur visite Mme Bertrand et ensuite se promène quelques temps dans le jardin avec le Grand Maréchal.
Le docteur (O’Meara) reçoit une lettre du capitaine Blakeney qui lui dit qu’il ne peut sortir de Longwood. Le Grand Maréchal envoie chercher le major Gorrequer pour affaires pressantes. Il arrive.
Le Grand Maréchal lui dit qu’il y a peu de jours il lui a dit que l’Empereur avait vu avec une peine extrême le changement de fournisseur, que les relations que nous avions avec la maison Balcombe — que nous connaissions depuis notre arrivée et la seule de l’île avec laquelle nous eussions des rapports, — étaient pour l’Empereur une garantie de la manière dont était fait le service; qu’aujourd’hui il le fait appeler pour une question d’une bien autre importance.
Le Grand Maréchal donne à lire à Gorrequer la lettre du docteur qui annonce qu’il est soumis aux mêmes restrictions que nous tous. Le docteur ne veut pas s’y soumettre, est décidé à quitter sa place, quoiqu’il regrette infiniment de laisser l’Empereur malade dans cet état.
M. Gorrequer dit que, ne sachant pas de quoi on avait à lui parler, il a mission de ne rien dire ni de rien répondre. Cependant, il reste. Le Grand Maréchal continue : la combinaison du renvoi du docteur avec le changement de fournisseur a été pour l’Empereur la confirmation de ce qu’il soupçonnait depuis longtemps : qu’on voulait l’assassiner.
M. Gorrequer se lève et dit qu’il ne peut en entendre davantage, qu’il engage le Grand Maréchal à écrire officiellement au Gouverneur. Il se retire.
Le Grand Maréchal écrit au Gouverneur pour protester contre le renvoi du docteur O’Meara, de quelque prétexte qu’on colore son renvoi. Le Gouverneur, depuis son arrivée, a voulu imposer le docteur Baxter. Celui-ci inspire à l’Empereur une répugnance invincible. L’Empereur ne verra aucun médecin qui ne soit de son choix. Il est décidé à mourir sans les secours de la médecine. Le Grand Maréchal est chargé :
1° de déclarer que le docteur O’Meara est le seul, sur ce rocher, en qui il ait confiance;
2° de protester contre le renvoi du docteur O’Meara, de quelque prétexte qu’on colore son renvoi.
Le capitaine Blakeney a dit au Camp qu’il ne pouvait pas supporter sa place, parce qu’un homme d’honneur ne pouvait pas la remplir; qu’on voulait qu’il espionnât le docteur, avec qui il mangeait tous les jours et qu’il ne le pouvait pas. Il avait, quelques jours avant, dit au docteur qu’il voulait quitter.
Le général Montholon voit le Russe et lui remet les diverses lettres relatives au docteur O’Meara. Il dit qu’il ne sait s’il les remettra à l’Autrichien (Sturmer), parce qu’il ne s’y fie pas; qu’en conséquence, nous ne lui en parlions pas, qu’il verra ce qu’il doit faire.
Depuis quelques jours, l’Empereur lit (titre illisible) :
J’ai été assez content des commentaires, surtout de Julien l’Apostat, qui était un habile homme. Mieux que Gibbon, il raconte et ne fait pas de réflexions. Peut-être pourrait-il en faire davantage, mieux faire comprendre comment Julien opéra si aisément une si grande révolution; il est vrai que la majorité de la nation était païenne et pour lui. — Comment parler avec justesse (de ce que l’on) a appelé la révolution du Retour de l’île d’Elbe, si on ne dit en quelques mots que l’armée n’étant pas changée était toute pour moi ? — Gibbon devrait être réduit à deux volumes, parce qu’il ne fait que des réflexions. Montaigne en un volume a mis dans ses Essais (lacune) c’est le résultat de mâcheries.
C’est une mauvaise manière de mêler ses réflexions aux faits. Il faut d’abord raconter, et ensuite faire ses réflexions.
Le colonel Reade visite le docteur et lui demande s’il a communiqué sa lettre à Longwood. Il répond que non. Il demande ensuite des nouvelles de Mme Bertrand et de l’Empereur. Le major Gorrequer écrit au docteur pour lui demander copie de sa lettre au Grand Maréchal. Il répond qu’il n’en a pas gardé copie.
Le major Gorrequer écrit une seconde fois pour lui demander copie de sa lettre au comte Bertrand. Il dit qu’il a dû en garder copie, qu’il a eu tort de parler de sa démission à l’Empereur avant de lui en parler (à lui), qu’il a eu tort d’écrire au Grand Maréchal sans communiquer sa lettre; qu’on sait bien qu’il veut partir depuis longtemps; que sa lettre lui est nécessaire pour l’envoyer au Gouverneur; qu’il en demande copie au comte Bertrand.
L’Empereur dîne au salon. Le docteur écrit une longue lettre au Gouverneur, dans laquelle il lui envoie sa lettre au comte Bertrand, que celui-ci lui a remise sans difficulté, alors que s’il l’avait donnée au major Gorrequer, le major eût pu la garder. Le docteur réitère sa demande de démission. Il est officier et n’est plus capable de faire son métier. Le Gouverneur n’a pas le droit de lui imposer des restrictions. Il a fallu un bill du Parlement pour en imposer à Napoléon seul. Pour les imposer à ses officiers, il a fallu leur consentement. A plus forte raison le faut-il de la part d’un sujet britannique. Il regrette de quitter l’Empereur, mais le Gouverneur a voulu l’y forcer, l’a maltraité, a voulu le convertir en espion et le faire agir contre sa conscience. Il s’y est refusé. Il demande :
1° ou que le Gouverneur lève les restrictions et le laisse faire son métier, comme il l’a fait depuis trois ans;
2° ou à partir pour l’Angleterre et donner sa démission;
3° ou à être jugé par un tribunal compétent s’il a violé le bill du Parlement et, dans ce cas, qu’on le fasse juger en Angleterre par un jury.
L’Empereur, après dîner, joue beaucoup avec Hortense (Bertrand) qu’il voulait pour se distraire, qui ne l’attrape pas et pour jouer, dit-elle, obtient des sous d’or.
L’Empereur ne s’habille pas. Il lit au général Montholon la lettre du docteur qu’il avait, la veille, dictée à 2 heures du matin au Grand Maréchal.
L’Empereur vient au salon. Courses du 3 avril au 9. Le Grand Maréchal rencontre sur la route plusieurs officiers revenant des courses. Le docteur s’est abstenu d’aller aux courses, mais le Grand Maréchal lui persuade d’y aller, d’aller au Camp, d’y dîner, de parler aux officiers, de leur expliquer sa cause et de se les rendre favorables.
La lettre du Gouverneur n’est pas claire et le docteur peut supposer que les limites sont celles de l’enceinte. En admettant même l’expression « grounds de Longwood », le Camp en peut faire partie. Si on l’en chasse, il demande un ordre par écrit, afin de savoir quelles sont les limites et ce qu’il doit faire. Si le Gouverneur le voit en conférence avec tout le monde au Camp et dans les limites, il sait que, ne pouvant arrêter les communications, sa mesure est inutile. Aujourd’hui on suppose le docteur coupable et qu’on lui a imposé une punition, tandis qu’il faut présenter la chose comme une restriction (de liberté) à laquelle tous les officiers peuvent être sujets et qui intéresse tout le monde. Le docteur suit la conduite qui était dictée par ordre de l’Empereur. Tous les officiers du Camp à qui il parle approuvent sa conduite.
Le Grand Maréchal va en ville chez le Russe et le général Montholon déjeune avec lui. Le capitaine entre dans quelques boutiques. Montholon dit que son frère cadet a été nommé de la Chambre des Pairs ( ?).
On travaille à Plantation House à une réponse. On dit que le docteur ne devait pas cesser de faire ses fonctions de médecin, parce que la restriction n’était que momentanée. L’Empereur dicte une lettre pour le Gouverneur au Grand Maréchal. A envoyer si on ne reçoit pas promptement de réponse.
Le Grand Maréchal et Mme Bertrand visitent l’Empereur. Il ignorait que M…, le jeune, eût été valet de chambre du duc de Fleury et que Montholon prétendît l’avoir empêché d’être de la Chambre des Pairs. Maret l’avait présenté comme de la bonne bourgeoisie de Dijon, ayant 30.000 livres de rentes.
« Je pense que j’ai eu tort de ne pas causer davantage avec les femmes. Quel qu’occupé que soit un homme, il a des moments libres. J’eusse toujours trouvé une heure pour causer, faire appeler la Dame du palais qui se trouvait là. Quand on l’aurait su, on eût été exact à s’y trouver. J’aurais fait entrer une des Dames au salon, et là, sur le canapé, j’aurais causé une heure avec elle. J’aurais appris beaucoup de choses. C’est une rivière qui a besoin d’eau et à qui il faut en apporter : plus il y a de sources, mieux cela vaut. En général, je n’ai pas vu assez de monde. J’ai obligé tant de gens qui ne l’ont pas su, qui croyaient que c’était Fouché ou tel autre ministre à qui ils étaient redevables. Ils se trompaient. Peut-être ai-je cru qu’il valait mieux être vu de plus loin, que l’autorité du trône y gagnerait. Je me trompais. Cela pouvait être vrai dans l’origine, mais après le Consulat, non. Ma marche était alors si simple, si grande que je n’avais rien à redouter. J’étais bon à voir, je devais me montrer. On me l’a dit, je ne l’ai pas assez cru. Quand on rétrécit le cercle, il se rétrécit tous les jours davantage. J’avais vu beaucoup de femmes très frivoles et je croyais qu’elles l’étaient encore. Je fus très étonné quand j’ai causé avec elles de les trouver capables de raisonner, d’avoir une opinion et de la soutenir. Les femmes étaient beaucoup plus propres que les hommes à m’apprendre certaines choses. J’étais si grave, si décidé que les hommes n’osaient pas me dire bien des choses que les femmes disent. Il y a toujours entre un homme et une femme une certaine galanterie qui n’existe pas d’homme à homme.
Au retour de Leipzig, je voulais que le duc de Bassano donnât sa démission des Affaires Etrangères et reprit le Secrétariat d’Etat qui était sa vraie place. L’opinion était tellement montée contre lui que cela me parut nécessaire, quoiqu’il fût étranger à tout ce qui s’était passé.
Je crus réussir mieux en en parlant à sa femme. Je la trouvai au contraire peu disposée à cela. Au premier mot, elle regimba, les larmes lui vinrent aux yeux. Elle dit que c’étaient des cabales, des intrigues, que personne ne dirait rien si je conservais son mari, etc.
Le soir même, je fis appeler le duc de Bassano, car il fallait finir dans la journée, sans que celui-ci devinât l’intrigue. Je lui dis que l’opinion était contre lui, qu’elle lui attribuait la responsabilité de ce que la paix ne s’était pas faite à Dresde, que sans doute il n’en était rien, que j’avais tout fait, tout décidé, que personne ne le savait mieux que moi, mais que je me trouvais par les circonstances obligé de changer de politique, que, dans son intérêt, il devait quitter le ministère, que probablement l’ennemi allait envahir la France, que l’opinion lui reprocherait cela, que j’en serais fâché.
Le duc me comprit et reprit sa place de secrétaire d’Etat.
Au retour de l’île d’Elbe, Mme Lavalette voulait que je fisse son mari ministre. Cela était impossible : Lavalette n’était pas en ligne pour cela. Mais elle plaida vivement sa cause. Nous étions au moment où les courtisans acquéraient de l’expérience. Il est possible aussi que ce moment du règne des Bourbons eût donné un peu de ton aux esprits.
Lorsque M. et Mme B… me présentèrent leur famille, au retour de l’île d’Elbe, j’y vis de jolies demoiselles et me reprochai de ne pas les avoir mariées. J’aurais pu placer quelques-unes de ces jeunes personnes, les établir légalement dans toutes les familles d’Europe avec des primes dotales. Je pouvais ainsi en marier une quinzaine. En général, j’aurais pu faire plus de mariages comme celui du Grand Maréchal, qui étaient un lien, qui m’attachaient des familles et donnaient de l’assise au nouvel ordre de choses. Cependant Mme de Marbeuf, qui venait quelques fois me voir, me dit que j’aurais tort de me mêler de cela, que c’était se donner des embarras, que le Faubourg Saint-Germain n’était rien et qu’il courrait lui-même au-devant des mariages et les solliciterait si j’enrichissais ceux que j’élevais, mais qu’il fallait nécessairement que je fisse leur fortune, sans cela, c’était impossible ; que dans tous les temps les nobles avaient recherché la fortune. Laides, juives ou de la dernière classe, peu importe si l’on est riche. Il fallait donc que j’enrichisse les miens. En général je ne les ai pas assez favorisés.
Je dois cette justice à ceux qui m’ont environné qu’ils m’ont peu demandé. Je donnai, un jour, au duc de Bassano 600.000 francs. Je réglais un compte. Il y avait un reliquat. Je dis en riant au duc, j’ai envie de vous donner cela : — cependant je n’y pensais guère. Le duc rougit, fut ému. Je remarquai l’effet que ce mot avait produit.
Oh! Si cela vous fait un si grand plaisir, je vous les donne.
Et je les lui donnai.
Duroc ne m’a rien demandé. Vous ne m’avez rien demandé. En général, il faut demander à la Cour. Mme de Richelieu avait ce bon principe. Il n’en est pas des rois comme des autres hommes : il ne faut pas leur appliquer le principe bourgeois du « ne pas demander », seulement il ne faut pas avoir d’humeur si on n’accorde pas.
Defermon ne conserva pas le Domaine extraordinaire. Il fallait le laisser à la liquidation. Il devait faciliter la vente des dotations à l’étranger.
La famille de Marmier fit des démarches pour faire nommer M. de Marmier premier écuyer. L’impératrice Joséphine s’entremit, et tout le monde. Quand on m’en parla, je trouvai cela simple et dis que je le ferais. Cependant je réfléchis que je ne pouvais pas d’emblée faire premier écuyer M. de Marmier quand il y avait des généraux de division simples écuyers. Je le fis donc d’abord écuyer. Quand le décret arriva, Mme de Marmier fut prévenue. Elle m’en parla en disant que ce n’était pas là ce qu’elle avait demandé ; que, sous les Bourbons, jamais sa famille n’eût accepté une place de simple officier; qu’on ne leur pardonnerait pas de le faire aujourd’hui; qu’il y avait déjà tant de gens qui désapprouvaient leur conduite qu’ils ne pouvaient prêter le flanc (à leurs critiques).
Je voulus l’apaiser, lui faire comprendre que la place d’écuyer et de premier écuyer était à peu près la même chose — ce qui l’était effectivement à mes yeux; que je ne pouvais pas mettre au-dessus d’un général de division un jeune homme qui n’avait rien fait; que, sous les Bourbons, les Marmier avaient des droits par leurs anciens services à cette Maison, mais qu’ils n’en avaient pas près de moi; que d’ailleurs cela était contraire à mon système.
Je partis dans la nuit pour Austerlitz et ne changeai rien à mon décret. A 3 heures du matin, Mme de Marmier était sur mon passage, M. de Marmier en bottes, mais cela n’aboutit à rien. Je m’étais fixé des principes dont je ne pouvais m’écarter.
J’aurais peut-être rallié plus du monde du Faubourg Saint-Germain, en choisissant qui s’était bien montré, si j’avais eu une autre dame que la duchesse de Montebello. Cela aurait eu lieu et certainement, ç’eût été un bien. Je ne demandais pas mieux que de me rallier du monde par l’Impératrice.
Je n’avais pas nommé de gentilshommes de la Chambre, à cause du mot, j’avais dû prendre des chambellans. J’avais établi dans mon service une distinction du service d’honneur et de celui de la personne, qui, probablement, sera adopté en Europe. On me posa la question de savoir si je voulais pour valets de chambre et pour mon service des personnes d’éducation comme il y en avait auprès des rois, ou de vrais domestiques. Je répondis : de vrais domestiques, à qui je puisse donner un coup de pied au cul si je veux.
Le Grand Maréchal pense qu’il eût fallu revenir à l’ancien système, où les valets de chambre, comme les Gardes du Corps et tout ce qui approchait la personne de l’Empereur auraient été pris parmi les bons bourgeois et des personnes d’éducation comme cela se faisait. Déjà les huissiers, les valets de chambre, etc., habituellement, étaient des jeunes gens bien élevés. Il fallait des personnes dont la famille, l’éducation garantissaient la moralité au lieu de ces coquins de courtisans. Les hommes de la garde-robe et autres de cette espèce qui n’approchaient pas la personne (du souverain) devaient être réellement pris dans la classe des domestiques.
(Récapitulation des fautes.)
Ce n’est, au reste, à aucun des principes adoptés pour l’Intérieur qu’il faut attribuer la catastrophe de l’Empire.
« Les désastres de la guerre de Russie en ont été les seules causes. J’avais réussi dans tout ce que j’avais entrepris, je n’ai pu parer à cela. A Dresde, peut-être aurais-je pu traiter avant, lorsque l’empereur de Russie était à Kalisz. Ce devait être la première faute.
Alors M. de Hardenberg dit à M. de Saint-Mars que, si je voulais sincèrement rétablir la Prusse, elle ne ferait pas la guerre, mais qu’il fallait lui rendre ses places, lui rendre sa population ancienne. Si je voulais lui en assurer le retour, à ce prix, elle proposait une alliance sincère, ne donnerait pas passage à la Russie. Alors, connaissant les ressources de la France elle donnerait en mariage un prince de Prusse à quelque Française que j’adopterais. Le roi de Prusse a fait beaucoup de démarches pour que je mariasse son fils.
Si M. de Hardenberg parlait de bonne foi, comme cela est possible, car il connaissait les ressources de la France, alors je pouvais arrêter la Russie et prévenir ma chute.
La Prusse a été la puissance qui est le moins volontiers entrée dans l’alliance contre la France. L’Autriche n’a pas hésité un instant. Sa politique et son ambition ne lui permettaient pas de négliger cette occasion de rétablir sa puissance. Mon mariage (avec Marie-Louise), loin d’être un lien qui la retenait, fut un motif de plus qui la poussa à la guerre.
La guerre que j’ai entrepris le plus contre mon gré, c’est celle de la Prusse. Aussi n’est-ce pas moi qui l’ai faite, c’est la Prusse qui l’a voulue. Après un si grand succès que celui d’Iéna et la reddition de Magdebourg je ne pus résister au désir de profiter de ma victoire ; mais ayant ainsi humilié un ennemi, je devais l’anéantir. A Tilsitt, je le pouvais. La Russie eût abandonné la Prusse. J’avais été absent de Paris depuis 8 ou 10 mois. Je voulais y revenir et je me hâtai de conclure. C’est là une excuse mais non une raison. Le fait est que je pouvais anéantir la Prusse et le devais. Jamais je n’aurais dû lui laisser la Silésie. La Russie n’avait plus d’armées, elle ne pouvait déclarer la guerre, elle eût sacrifié la Prusse.
A Dresde, je ne pouvais faire la paix. L’Autriche ne la voulait pas. Non seulement, elle voulait les provinces illyriennes, ce qui ne faisait pas difficulté, mais encore Venise que, je lui eus peut-être cédée, mais encore le Mincio et Mantoue. Les Autrichiens voulaient une garantie contre moi. Ils prévoyaient que je ne leur pardonnerais pas cette condition et voudrais m’en venger. Ils voulaient avoir une frontière en Italie et une sûreté. Personne n’eût accepté de pareilles conditions, qui peut-être n’étaient pas offertes de bonne foi. Cependant j’hésitai. Les Autrichiens craignaient l’armée d’Espagne. Ils disaient : si l’Empereur s’arrange avec l’Espagne, il va ramener cette armée au cœur de l’Allemagne. Mais dans ce moment arriva la nouvelle de Vittoria. On sut le succès de l’armée anglaise et que, loin de pouvoir ramener l’armée française sur le Rhin, nous ne pouvions pas même arrêter l’armée ennemie sur nos frontières. L’Autriche fut alors tout à fait décidée.
Les faits prouvent que je pouvais reculer (la décision), puisque, 48 heures après la bataille de Dresde, M. de Metternich écrivit pour demander la paix. Les Autrichiens sont toujours à genoux dès qu’ils sont battus. Mais le désastre de Vandamme arrêta ces propositions et releva le courage des Allemands.
La bataille de Dresde, où je battis la grande armée alliée, où étaient les trois souverains, est certainement la plus belle action de cette campagne. Le désastre de Mac Donald, auquel peut avoir contribué l’aventure de Gourgaud, fut un coup funeste. Voici ce que c’est : Je ne pouvais laisser le commandement à Mac Donald, sans retirer Ney qui était son ancien. J’envoyai à ce dernier l’ordre de venir me rejoindre de sa personne. Le duc de Vicence et Gourgaud écrivirent l’ordre et la minute. Je me couchai. Le général Gourgaud soutint à Caulaincourt. que j’avais dit : de sa personne seulement, Caulaincourt : avec son corps. Je dormais. L’ordre fut expédié. Cependant un remords prit à Gourgaud. Il vint trouver le duc de Vicence pour lui dire qu’il était presque sûr qu’il y avait méprise. Celui-ci dit d’aller trouver le prince de Neufchâtel, qui ne voulut pas m’éveiller. En conséquence, Ney se mit en mouvement avec son corps, qui ne se trouva pas à la bataille. On lui envoya un contre-ordre mais qui n’arriva pas à temps. Je crois que l’opinion personnelle de Caulaincourt étant que le corps de Ney était nécessaire pour la bataille l’avait porté à laisser l’ordre tel qu’il était effectivement ; avant, j’avais eu intention de mener ce corps à Dresde.
Deuxième faute :
Après les affaires de Russie, je devais finir les affaires d’Espagne qui ne pouvaient réussir, de même que dans un voyage à Fontainebleau, j’avais fini mes affaires avec le Pape : par une transaction. Je devais aller à Valençay, en 48 heures terminer avec Ferdinand, l’envoyer en Espagne et retirer mon armée. Alors avec cette armée, j’étais maître de l’Allemagne, puisque, sans elle, j’étais si fort à Lützen et à Würschen. J’aurais eu de la cavalerie et de vieilles bandes, les effectifs qui firent ma force (…). La cavalerie fut ce qui me manqua davantage. Il y avait en Espagne quelques vieilles troupes et des régiments entiers comme ceux que j’ai ramenés d’Italie.
Troisième faute :
C’est d’avoir fait venir à Dresde les réserves nouvellement levées et les 10.000 hommes des Gardes d’Honneur. Il fallait les laisser sur le Rhin à Würschen. Au retour de Leipzig, j’eusse trouvé 100.000 hommes de troupes exercées, 80.000 hommes de cavalerie, qui ne m’ont servi de rien et qui auraient été fort précieuses et fort utiles. La Hollande ne se fut pas insurgée, s’il y avait eu là quelques Gardes d’Honneur ou un bataillon. Alors, avec cette réserve, je formais une nouvelle armée, comme après la Russie.
Quatrième faute :
J’aurais dû, au retour de Leipzig, lever sur-le-champ 100 bataillons de Gardes Nationaux. Ils pouvaient être sur le Rhin à la fin de décembre ou au commencement de janvier. En deux mois, cela pouvait être fait, comme l’a prouvé ce que j’ai fait au retour de l’île d’Elbe. Alors je retirais de Mayence le VIe corps et les garnisons des places. Les troupes de Mayence, qui étaient de 12 à 15.000 hommes d’excellentes troupes, auraient été le noyau de 30 à 40.000. Alors, au lieu des 24.000 hommes que j’avais à Ligny quand j’ai commencé la campagne, j’aurais pu en avoir 100.000. Alors tout était changé, le succès certain.
Cinquième faute :
Mais la plus grande faute est d’avoir fait l’armistice de Silésie. J’avais un succès et le dessus sur l’ennemi. Je devais en profiter, le pousser, ne pas accorder d’armistice (à Plesswitz). Si je m’étais porté, avec 150. 000 hommes sur Breslau, faisant insensiblement appuyer sur moi ma droite, il fallait que l’ennemi évacuât la Silésie et que les Russes repassent la Vistule. Alors l’Autriche ne se déclarait pas. La Pologne s’insurgeait. La question était toute différente. Berthier qui voulait toujours rentrer à Paris et Caulaincourt, furieux de l’avance de l’armée Soult, influèrent aussi sur ma détermination.
Sixième faute :
A Châtillon, j’aurais pu signer la paix et l’avoir un peu meilleure que celle des Bourbons (sic), mais peu. C’est la seule circonstance où j’aurais pu signer la paix.
Je n’aurais pas dû nommer le duc de Raguse ni Oudinot maréchaux. Ils devaient gagner une guerre. Masséna y avait de véritables droits : il avait commandé à Zurich. Augereau, non. Je trouve que Masséna avait beaucoup gagné. Les trois meilleurs de mes généraux furent Davout, Soult et Bessières. Ils ont assurément réussi. Mortier était le plus faible. Davout aura une place dans l’histoire à cause de Iéna. Il s’est bien conduit à Eylau, mais talonné à Wagram il arrive tard et est la cause de la perte d’une bataille, la veille. Le soir même du passage, je voulus emporter les hauteurs par une échauffourée, afin d’éviter la bataille. C’est la manière de prendre les Autrichiens. Si vous les laissez faire leurs dispositions, ils les font bonnes et se battent bien. Mais Davout n’arriva pas et fut cause de la bataille du lendemain. Il s’est fait du tort à la Moskowa.
Le prince Eugène s’est bien battu à Leipzig. Marmont (à Leipzig) me fit demander deux fois du secours. Je ne comprenais qu’il eût besoin de secours quand l’ennemi me livrait à moi-même une grande bataille. Certain d’être sans infanterie sur ma droite, je demandai à l’aide de camp si toutes les troupes étaient engagées et si les réserves avaient donné. Il ne sut point répondre. J’envoyai un de mes aides de camp qui vint me dire que, comme je l’avais prévu, le duc de Raguse n’avait devant lui que de la cavalerie, que les deux divisions Bonet et Compans ne s’étaient pas encore battues. Alors au lieu d’envoyer du renfort, je fis venir à moi la division Bonet.
Septième faute :
J’aurais dû porter la guerre sur la Saale.
Narbonne est le seul ambassadeur que j’ai eu. Quinze jours après son arrivée (à Vienne), il envoyait toutes les circulaires d’Autriche dépeignant les desseins des Russes pour lever des troupes et se préparer à la guerre.
Metternich me l’avait dit : vous avez un pauvre corps diplomatique. Vous ne pouvez avoir d’ambassadeurs que dans la noblesse. C’est elle qui gouverne en Europe. Nous ne fréquentons pas d’autres personnes (que les nobles). Narbonne est le seul ambassadeur que vous puissiez envoyer en Autriche. Il couchera avec Mme Bagration. Il donnera le ton. On le verra, le matin, en redingote, etc. »
Metternich parlait ainsi lors du mariage et se repentit ensuite d’avoir donné ce conseil.
Otto, disait-il encore, peut être bon en Amérique où même en Angleterre, mais chez nous, non. Nous irons à un grand dîner qu’il donnera en grand habit, et ensuite nous ne le verrons plus. Au lieu que Narbonne voyait le vieux prince de Ligne qui était précieux, savait tout, bavardait. Il discutait avec l’empereur d’Autriche. Il eut une discussion avec lui, dans laquelle il le pressa : « Mais enfin, vous ne voulez pas faire la guerre à votre gendre ! », et il força un jour l’Empereur à lui avouer que si. La noblesse, élevée avec les rois, accoutumée à jouer avec eux et à lire leurs pensées est, au fond, la seule propre aux ambassades. Ce fut à lui, Narbonne, que les grands seigneurs s’ouvrirent pour le mariage. C’est lui qui l’a fait.
Je causais peu avec mes chambellans. Je ne m’y fiais pas. J’avais tort. Il est vrai qu’il y avait chez eux peu de ressources.
La duchesse de Bassano ne voulait pas (pour son mari) de la place de secrétaire d’Etat qui était trop assujettissante. Elle ne pouvait avoir jamais personne à dîner : son mari venait travailler à 6 ou 7 heures. Jusqu’à 9 heures, je le faisais appeler à tout instant, il ne savait sur quoi compter.
Cela est facile à arranger, dis-je, mais ce n’est pas la vraie raison.
Le ministère des Relations extérieures était certainement le plus beau dans l’état de gloire où était la France. Le Secrétaire d’Etat réunissait plusieurs fonctions qui étaient étrangères à la place et qu’il était facile d’en tirer, comme toutes les notes pour le Moniteur et celles qui résultaient des travaux des ministres. Le duc de Bassano avait des secrétaires qui remettaient cela en ordre. Il aurait pu avoir un sous- secrétaire d’Etat qui travaillerait directement avec moi, mais c’est ce que ne voulait pas le Secrétaire d’Etat qui entendait travailler seul avec moi. Peu m’importait avec qui je travaillais, comme je tirais (tout) de mon propre fonds, cela m’était indifférent.
L’ambition et la commodité ne vont pas ensemble. Puisque Maret voulait travailler avec moi, remuer beaucoup de matières importantes, il fallait qu’il y mît son temps.
La place de Secrétaire d’Etat était trop considérable. C’était un premier ministre. Je voulus et tâchai de la diminuer. Par exemple, il avait la signature des places et des nominations, ce qui faisait beaucoup de peine aux ministres. Le duc de Bassano en a abusé quelques fois. Il y a des décrets qu’il n’a pas envoyés, ou bien il prévenait des nominations avant que les décrets fussent expédiés, de sorte que telle personne venait chez le ministre le remercier de sa nomination et lui apprenait qu’elle était nommée… quand lui-même n’en savait rien.
Je voyais trop peu mes ministres et leur écrivais trop. Ils eussent dû faire avec moi le travail de la signature et n’apporter au Conseil que les objets de discussion. Les ministres disaient qu’ils présentaient un sujet recommandable et que le Secrétaire d’Etat l’écartait souvent avec un mot : c’est un bourboniste, ou un terroriste ou un voleur — ce qui souvent n’était pas fondé.
L’Empereur a lu la brochure qu’a faite Fouché.
Elle parle de lui comme de l’homme le plus important de la France, et c’était un homme nul. Il n’y a eu (d’après lui) dans la Révolution que trois hommes : Carnot, Sieyès et lui. Je ne l’ai renommé ministre la seconde fois que parce que je le considérais comme un homme nul, mais qui avait le tran-tran de la place. Il a la figure d’un chat et il est futé comme lui, mais voilà tout. On croirait à l’entendre qu’il a tout fait, tout prévu, tout dit, et il n’a jamais donné un conseil. Il parle de lettres à moi écrites, qui sont fausses. Jamais Fouché ne m’a parlé sur ce ton. Au reste, ceux qui liront ces lettres doivent se dire que cet empereur qui passe pour si terrible devait être un bien bonhomme de se laisser dire tant d’impertinences.
Ce qui a fait Fouché redevenir ministre, c’est Fontanes. Fouché s’étant aperçu que je voyais Fontanes et avais quelque familiarité avec lui, s’en rapprocha, apparemment pour pouvoir s’en étayer. Fontanes me dit, un jour, que Fouché était estimé, qu’on le verrait avec plaisir à la place de ministre de la Police, celui de la Justice (Regnier) étant nul.
Mais je ne suis pas éloigné de cela, dis-je.
Je le nommai une deuxième fois.
Fouché, en fait, était l’homme le plus opposé à la liberté publique et à la liberté de la presse.
Le Grand Maréchal envoie au Gouverneur une lettre pour demander qu’il lève les restrictions du docteur O’Meara. L’Empereur a fait appeler le Grand Maréchal deux fois dans la nuit. Depuis douze jours, il attend réponse à la lettre du 13 (mars) et est sans le secours de son médecin.
Le Grand Maréchal reçoit à 6 heures du soir une lettre du Gouverneur, datée du 21, dans laquelle il dit qu’il a demandé au docteur pourquoi il ne sortait pas.
Le docteur a déclaré, le 25 mars, qu’il y avait commencement d’hépatite, tandis que le comte Bertrand écrit qu’il y a maladie chronique, ce qui implique contradiction. — Il n’a jamais voulu chasser le docteur O’Meara ni le remplacer par Baxter, qui ne le pouvait à cause de ses importantes occupations. — Il ne comprend pas la répugnance de Napoléon pour Baxter, puisqu’un général, le comte Bertrand, a fait des efforts pour persuader à Baxter que Napoléon avait la plus grande confiance en son caractère et ses talents.
Le colonel Reade envoie une lettre de 8 pages au docteur : le docteur n’est pas assimilé aux prisonniers français, puisqu’ayant obtenu la permission de sortir, il n’est pas accompagné par un officier. Il est sous les ordres du Gouverneur, qui a le droit de le faire rester ]à où l’appelle son service. Il a désobéi, et, si ce n’était l’Empereur, il l’aurait déjà puni.
Le major Gorrequer demande au docteur s’il a refusé de faire ses fonctions de médecin et s’il a vu l’Empereur depuis le 12 (mars). Celui-ci répond que l’Empereur l’a fait appeler, le 14, lui a fait ses adieux, lui disant qu’il le remerciait de ses soins, de quitter ce foyer de ténèbres et de crimes; que le monde ne concevrait pas qu’on eût attenté à son médecin; qu’il n’avait plus son indépendance ; qu’il mourrait rongé de maladies sur son grabat.
M. Cole, que le Grand Maréchal faisait demander depuis dimanche et qu’en six jours il a demandé trois fois au capitaine, vient chez le Grand Maréchal, mais ne veut lui parler qu’en présence du capitaine. Le Grand Maréchal fait appeler le capitaine, lui demande s’il a ordre d’être présent à son entretien. Il dit que non, que c’est M. Cole qui le désire. M. Cole est pusillanime et supplie que le capitaine soit présent, qu’il a pour cela la sanction du Gouverneur qui l’a requis — vu que ses affaires étaient finies — de lui dire ce que je lui demande.
Le comte Bertrand répond qu’il ne souillera pas sa maison (sic) ; que le cas s’est déjà présenté avec le capitaine Poppleton, une fois, lors de l’affaire du Buste, avec M. Jackson, lors de l’affaire du général Gourgaud, avec le capitaine ((Blakeney) lui-même, il a pris la même détermination; que d’ailleurs M. Cole étant obligé de rendre compte de sa conversation, ce serait se soumettre à un espionnage; qu’il ne se pliera jamais à une telle condition, quoiqu’il eût plusieurs choses importantes à lui dire; qu’il reconnaissait la marche ordinaire du Gouverneur et ses insinuations. Il a l’offense exprimée dans toute sa figure. Voilà donc la liberté que nous avons de voir les habitants ! Cela confirme tout ce qu’a dit le docteur.
L’Empereur fait divers projets de réponse au Gouverneur.
Envoyée au Gouverneur la lettre datée du 24.
Le Grand Maréchal remet au docteur la réponse que l’Empereur avait dictée. A 8 heures du soir, le Grand Maréchal reçoit une lettre de sir Thomas Reade, datée du 25, et le docteur en reçoit une, de Reade, datée du 19. L’Empereur ordonne au Grand Maréchal de renvoyer la lettre de Reade au Gouverneur, avec la lettre datée du 26. Le Grand Maréchal la remet au capitaine à 9 heures du soir, en me priant, vu l’urgence des circonstances et la santé de l’Empereur, de faire porter sur-le-champ cette lettre au Gouverneur. A 1 heure et demie du matin, le capitaine envoie chez le Grand Maréchal une lettre du major Gorrequer, datée de 11 heures du soir, qui renferme la lettre de Reade et la lettre du Grand Maréchal.
Le Grand Maréchal voit l’Empereur au bain. Il dicte l’apostille à la lettre de Reade et le Grand Maréchal l’envoie à midi au Gouverneur, avec une lettre datée du 27 (*). A 5 heures du soir, le Gouverneur renvoie au Grand Maréchal les deux lettres des 26 et 27 avec une simple enveloppe contresignée de lui.
Dîner avec l’Empereur.
Un brick russe qui a fait le tour du monde se présente. A son arrivée, le commandant demande à parler au commissaire russe. On tergiverse, on part prévenir le commissaire russe qui fait aussitôt une dépêche pour l’Europe. On la porte. Dans l’instant, le brick part sans qu’il soit possible à M. Balmain de communiquer avec lui.
Rien de nouveau.
L’Empereur dicte la réponse du docteur à la lettre de Reade, du 19.
Le Grand Maréchal et sa femme dînent avec l’Empereur, qui travaille sur Waterloo.
Le Grand Maréchal va en ville. Il parle à sept personnes de l’affaire du docteur, particulièrement à Mme Balcombe, qui l’ignorait, au directeur de l’artillerie, qui a paru y prendre un intérêt particulier. Il dit à Mme Balcombe que le Gouverneur avait déjà voulu empêcher Poppleton d’aller èn ville et qu’il est probable que l’actuel ne pourra plus, avant peu, y aller. Il rencontre M. Balmain à cheval, avec l’aide de camp. Balmain dit que la conduite envers le médecin de l’Empereur est infâme, que c’est un véritable attentat.
Lettre du Gouverneur au docteur pour lui demander des explications, et, le soir, projet de réponse :
« Le docteur doit éviter toute conversation, parce que les déclarations des agents du gouvernement font foi au Parlement. Le gouvernement anglais est accoutumé à agir ainsi. Ils m’ont déclaré la guerre sur la fausse déclaration du gouvernement que j’armais dans tous les ports, quand il était constaté et su de toute la marine que cela était faux. Les fausses conversations de lord Whitworth à Paris motivèrent la déclaration de guerre. Cette manière de gouverner m’étonna beaucoup. On ne comprend rien à cela : il n’y a ni vérité ni logique dans les discussions et dans les votes. Je m’en étonnais beaucoup avec Talleyrand. Les Anglais qui n’étaient pas accoutumés à lutter avec des gens qui raisonnent furent battus dans toutes les discussions qui se présentèrent. »
Le Grand Maréchal entre dans quelques détails avec le docteur, pour lui faire bien comprendre sa position. Il insiste particulièrement sur trois points :
1° Il est le docteur de l’empereur Napoléon. Ce sera là sa sauvegarde, si jamais il est accusé. C’est ce que son avocat aura à dire de positif en sa faveur. La lettre de l’amiral Keith, la lettre exigée du Grand Maréchal pour l’avoir (à Longwood), les lettres de change tirées comme médecin de l’Empereur sont autant de preuves.
2° II ne doit jamais avoir de conversations : toutes ses déclarations seront contre lui, elles seront faussées : on lui fera dire ce qu’il n’a pas dit, mais elles feront foi. Il lui est impossible de s’en tirer s’il parle. Il doit donc positivement se placer sur sa consigne, ne répondre à aucune question, dire : écrivez-moi, je répondrai. Le Gouverneur s’est montré son ennemi et son accusateur; il ne lui doit rien qu’un compte rendu officiel de la santé de l’Empereur; il répondra aux questions d’un enquêteur, non à celles du Gouverneur.
30 II doit écrire à l’amiral pour bien faire connaître sa position. Les réponses qu’il a faites à l’amiral sont la véritable cause de la persécution qu’il éprouve.
M. Sturmer ayant demandé au Gouverneur des bulletins (de santé) de l’Empereur, il a répondu qu’il n’en avait aucune nouvelle; que le docteur O’Meara n’en envoyait aucune, que tout ce qu’il pouvait dire, c’est que Napoléon vivait.
Conversation avec l’Empereur :
En Angleterre, les familles des Pairs ont toutes leurs parents dans la Chambre des Communes. Là, les ministres doivent être d’accord avec le Parlement. C’est une véritable autocratie qui gouverne. En France, la Chambre des Pairs n’est rien. Elle ne pourrait rien contre la volonté nationale. Le jour où la Nation se prononcera fortement, où il y aura une véritable opinion nationale, tout sera culbuté. Les Bourbons ne sont pas assis.
La population de Paris est très différente de celle de Londres. Les têtes se montent bien autrement. A Londres, on tire sur le peuple. On ne le ferait pas à Paris : les barricades se formeraient partout. Il sera impossible d’avoir jamais en France une armée qui soit réellement contre la volonté nationale. Le jour où il y aura une grande volonté nationale, le peuple et l’armée auront la même volonté. Il arrivera ce qui est déjà arrivé au commencement de la Révolution (…). »
Les Commissaires viennent à Longwood. On déjeune dans le jardin. On y fait porter trois plats, notamment une crème et du dessert, avec quelques bouteilles de vin. Ces messieurs sont très gais. M. de Montchenu et son aide de camp s’y trouvent. Mme Sturmer n’y était pas. On conte l’affaire du docteur O’Meara. L’Empereur n’a pas dit précisément parlant qu’on voulait l’assassiner, mais que la marche du Gouverneur est celle d’un homme qui aurait ce projet. Le Grand Maréchal remet à M. Sturmer les pièces. M. Sturmer dit qu’il se chargera d’envoyer la lettre, il réclame le secret. Il donne le journal. Il ne veut pas qu’on en parle à M. Balmain. M. Balmain dit qu’il n’a pas d’occasion d’envoyer la lettre et refuse en conséquence de s’en charger. Il demande au Grand Maréchal s’il n’approuve pas sa conduite. Il répond que M. Balmain doit mieux que lui connaître sa position et qu’il est meilleur juge de ce qu’il doit faire. M. Sturmer doit venir dans 15 jours pour prendre la lettre.
Le storeship arrive d’Angleterre. Le Gouverneur envoie au Grand Maréchal une lettre de M. Baring qui annonce qu’il a placé pour lui environ 160.000 francs en Amérique, lesquels rapporteront 9.000 francs. Il envoie le Morning Chronicle du 6 au 12 décembre, parce qu’il y est dit que Las Cases est conduit en prison et maltraité.
Lettre du colonel Wynyard au docteur, par laquelle il l’accuse d’avoir reçu une tabatière.
Lettre du major Gorrequer au docteur, par laquelle il lui ordonne de cesser toute correspondance. Il peut venir à Plantation House ou aller chez l’amiral s’il a besoin de quelque explication.
L’Empereur dicte un projet de réponse du Grand Maréchal au docteur et du docteur au colonel Wynyard. Le colonel dit au docteur qu’il peut communiquer sa première lettre de Reade au comte Bertrand. On en prend occasion de faire un projet de réponse dans lequel on met dans la bouche de l’Empereur qu’à l’arrivée de sir Lowe, il dit : Lowe est arrivé gros d’un grand crime, qui sera à terme lorsqu’il touchera au fournisseur des vivres et à mon médecin. Après le 10 avril, le moment est arrivé, sir Lowe marche à découvert.
L’Aventure est arrivé. Il porte l’ouvrage de Wilson et les Lettres du Cap.
L’Empereur dit au Grand Maréchal :
« L’opinion que j’étais un despote était répandue. Vous-même vous me croyiez despotique. »
Il répond : je sais pertinemment que votre gouvernement n’était pas militaire. Dans aucun pays, on n’a mieux distingué les autorités civiles, judiciaires et militaires. Les généraux n’avaient aucun commandement en France. La juridiction même était à la disposition des préfets et de l’autorité civile. Je sais cela, je l’ai remarqué dans vingt circonstances et (…) je crois que vous sentiez tout l’avantage d’une telle distinction de pouvoirs dans les subdivisions. Vous la jugiez nécessaire et la vouliez aussi, pourvu que personne ne résistât à vos volontés, peu vous importait quelle opinion on eût.
Le Conseil d’Etat savait bien, dit l’Empereur, combien j’étais ennemi de l’arbitraire et du gouvernement militaire. C’était toujours moi qui défendais les principes, les intérêts du peuple.
Le Gouverneur envoie les Courriers du 6 au 20 janvier. Les numéros du 24 au 30 manquent, et quelques autres. Las Cases est à Francfort.
L’Empereur lit Jean-Jacques (Rousseau) :
Ces Confessions autrefois m’ont beaucoup intéressé. Mais cela n’est bon qu’à 18 ans. C’est une lecture qui n’est plus supportable dans un âge avancé. Jean-Jacques n’a pas de titre pour aller à la postérité comme Machiavel, Montesquieu ou Voltaire. Il débute par dire : Quand le Jugement dernier arrivera, je me présenterai, mes Confessions à la main, et s’il est un homme meilleur que moi, qu’il ose paraître. Il faut répondre qu’il n’y en eût pas de pire (biffé et remplacé par : qui ne soit meilleur) parmi les hommes qui sont nés au-dessus du besoin et qui ont reçu quelqu’éducation. Il est voleur, il se fait fouetter, il partage sa maîtresse avec un domestique, il change de religion, la chose qui répugne le plus aux hommes, et cela sans motif; il épouse sa servante et met ses enfants à l’hôpital. Il dit que la femme d’un charbonnier est plus estimable que la maîtresse d’un roi. Non, ce mot est bien dans la bouche d’un prêtre. C’est un principe de la religion : aux yeux de Dieu, tous les hommes sont égaux, souverains et sujets. La maîtresse d’un roi est comme la maîtresse d’un autre homme, mais un roi est plus excusable qu’un autre homme. C’est la politique qui le marie; il n’a jamais vu sa femme, il ne la connaît pas. Le choix du roi suppose dans la maîtresse des grâces, du talent; elle peut influer sur les destinées de l’Etat. On ne doit pas comparer. Les ministres de Louis XV étaient heureux qu’il eût une maîtresse : sans elle, on ne pouvait souvent lui arracher une signature. Marie-Thérèse écrivait à Mme de Pompadour : ma chère amie ». Elle avait raison, et l’alliance de la France avec l’Autriche pouvait dépendre d’elle.
Le docteur reçoit une lettre de sir Thomas Reade, datée du 7 (avril), qui répète les restrictions du 10 du mois précédent, mais le considère comme le médecin de l’Empereur. En conséquence, il ne doit y avoir aucune objection à ce qu’il reprenne ses fonctions comme par le passé.
Billet du Gouverneur au comte Bertrand, pour le prévenir que le docteur peut reprendre ses fonctions, que les restrictions sont levées jusqu’à la réponse du gouvernement. Lettre du Gouverneur au docteur, datée du 8, pour qu’il prévienne, quand il aura repris ses fonctions.
Le Gouverneur visite Longwood à cheval, avec le colonel Wynyard. Il envoie les extraits des dépêches de lord Bathurst. Il a reçu les Observations et les renverra au gouvernement pour avoir son avis. D’après les dépêches du gouvernement, il donne sur deux points une solution :
La première que l’Empereur peut rentrer à 9 heures, mais qu’il doit consentir à ce que l’officier d’ordonnance le voie, le soir; la seconde, qu’il peut faire une liste de cinquante visiteurs.
L’Empereur prétend qu’il n’y a rien à faire avec le Gouverneur actuellement; qu’avec une liste de cinquante visiteurs, on ne verra personne, parce qu’il y aura de mauvaises insinuations et qu’il empêchera sous mains de venir.
Le Grand Maréchal écrit au docteur qu’il peut reprendre ses fonctions, mais à condition : 1°, qu’il fasse toutes les semaines un bulletin de la santé de l’Empereur, qu’il lui remettra; 20, qu’il ne parle de la santé de l’Empereur qu’au Gouverneur seulement.
Le docteur répond au Grand Maréchal qu’il accepte ces conditions et lui envoie le premier bulletin. Il l’envoie aussi au Gouverneur, avec une lettre du comte Bertrand et sa réponse.
Le major Gorrequer renvoie toutes les lettres en disant qu’elles sont une nouvelle infraction aux restrictions, et que, lorsque le Gouverneur voudra des renseignements sur la santé de l’Empereur, il lui fera connaître dans quels termes il veut qu’ils lui soient envoyés.
L’Empereur désire lire l’ouvrage de Wilson.
M. Sturmer vient. Il ne peut se charger de la lettre. M. Balmain a bien parlé pour le docteur. Le Grand Maréchal va en ville et fait des achats pour sa femme, à la boutique du store-ship. Il passe 1 heure et demie chez le comte Balmain, y déjeune. Ce dernier lui dit que le Gouverneur est venu chez lui, le lendemain de sa visite à Longwood. Il avait fait dire qu’il n’y était pas; alors le Gouverneur s’était rendu chez le baron Sturmer, lui avait parlé du docteur, lui avait dit qu’il s’était rendu passible de prison, qu’il avait violé les restrictions et qu’il avait dû lui interdire d’aller en ville. M. Sturmer était avec M. de Montchenu. Il avait gardé le silence, et interpellé de dire s’il n’approuvait pas sa conduite, M. Sturmer répondit que de la manière dont il présentait les choses, il ne pouvait l’en blâmer.
Le lendemain, le Gouverneur a écrit à M. Balmain que, s’il désirait quelques renseignements sur l’affaire du docteur, il les lui donnerait. M. Balmain s’est alors rendu à Plantation House. Le Gouverneur lui a demandé ce qu’il pensait de l’affaire du docteur. Celui-ci a répondu que s’il lui permettait de lui parler avec sincérité, non comme homme public, mais comme le ferait un particulier, il l’engageait à finir cela le plus tôt possible — c’était le 6; que s’il arrivait que l’Empereur vînt à mourir, il ne pourrait affirmer devant l’opinion de toutes les cours d’Europe qu’il l’avait empêché; que son gouvernement serait inondé de libelles en Angleterre et dans toutes les parties de l’Europe, et que tout ce qu’il pourrait faire ou dire ne pourrait changer l’opinion.
M. Balmain a ajouté dans la conversation que si le docteur était coupable, il fallait le faire juger, condamner et punir publiquement, d’une manière authentique, de manière qu’on ne pût retenir aucun doute dans l’opinion de l’Europe; que si sa faute n’était que bagatelle, il fallait laisser cela et n’en plus parler.
Le 8, M. Sturmer, étant allé en ville, a causé avec le colonel Reade pour demander des explications sur ce que le Gouverneur lui avait dit et qu’il n’avait pas bien compris. Probablement, il ne voulait pas avoir l’air d’approuver la conduite du Gouverneur.
Le docteur va en ville. L’officier d’artillerie arrivé par le store-ship dit qu’en Angleterre il y a un cri général de tout le peuple sur la honte de retenir ici l’Empereur et la manière dont il est traité.
L’Empereur ne sort pas.
Un bâtiment arrive du Brésil. La princesse Léopoldine n’est pas agréable au Brésil, le prince est lourd, laid. Lorsqu’en arrivant, elle lui a présenté la main en lui demandant s’il parlait français, il lui a répondu qu’il ne savait que le portugais. Les bricks anglais devaient être visités par la frégate portugaise, ce qu’on n’a pas fait. Il paraît que les Anglais sont mal vus à Rio de Janeiro.
L’Empereur ne sort pas. Il pense qu’en quatre jours il pourra lire l’ouvrage de Wilson.
Conversation sur le Suicide. Bertrand dit que l’Empereur eût dû se tuer.
Il faut renvisager la question, au lieu de la présenter comme elle l’est ordinairement par Jean-Jacques et autres. Il n’y a nul doute, dit l’Empereur, que l’homme n’ait le droit de se tuer, mais que le moment n’est jamais arrivé. Brutus et Cassius en se tuant firent perdre la bataille de (Philippes). Si Catilina ne se fût pas tué, de quelle utilité n’eût-il pas été pour la République, trois ans après, lorsque César fut assassiné. Il se fût trouvé dans le Sénat à côté de lui. S’il ne voulait pas se soumettre à César ne pouvait-il aller en Espagne avec les fils de Pompée, qui si longtemps y prolongèrent la guerre ? Je pouvais me tuer à Fontainebleau, sans doute, mais c’était une lâcheté, parce que je ne pouvais pas supporter mon malheur. Qui sait ce qui peut arriver ? Sur le Bellérophon, qui pouvait me porter à me tuer ? La lâcheté seule, à moins de ne pouvoir prolonger ma vie sans honte. Or ce n’était pas le cas. On m’a arrêté, on m’a conduit ici, on a voulu, il est vrai, m’avilir, mais je m’y suis soustrait en restant chez moi.
Le Gouverneur demande à Darling si à Longwood on lui a parlé d’un changement (de résidence) et qu’on dût habiter Plantation House.
L’Empereur se promène dans le jardin.
Le Grand Maréchal dîne avec l’Empereur. Il fait un projet de tour de 30 toises de côté extérieur avec un parapet en maçonnerie de 6 pieds 2 toises pour la batterie et un « cavalier ». Il revient à l’idée de Savournin s’il ne serait pas bon de faire des parapets en fonte.
On dit que l’ordre a été donné au Corps de Garde pour que nous puissions rentrer à 9 heures du soir, mais les sentinelles sont toujours placées à 6 heures.
Le docteur reçoit une lettre du colonel Wynyard et une autre du colonel Reade qui lui dit que lorsque l’Empereur sera dangereusement malade il doit en informer directement le Gouverneur, et, s’il ne peut aller à Plantation House, le dire au capitaine.
L’Empereur dîne à table. Le Grand Maréchal commence les Lettres de Warden. On pourrait peut-être y faire une réponse comme aux lettres de lady Morgan. L’Empereur travaille 1 heure à Waterloo (à la relation de la bataille).
Waterloo doit être un ouvrage national, écrit en entier à la gloire de la France. Il faut donc en ôter toutes les particularités qui pourraient faire quelqu’ennemi à l’ouvrage. Il ne faut pas parler de l’abdication, ce qui mettrait dans la nécessité de blâmer en passant et de se mettre les contemporains à dos.
Les Anglais n’avouent que onze mille hommes de pertes, c’est-à-dire, onze mille Anglais, mais leur perte totale est de vingt-six mille hommes, la Prusse, trente-huit mille. Total 64.000, perte très supérieure à celle de l’armée française, malgré les six mille prisonniers.
Le Grand Maréchal dîne avec l’Empereur et achève la lecture de Waterloo.
Wellington a fait une faute en ne s’organisant pas mieux pour savoir ce qui arrivait sur la frontière, quand il savait l’armée française en mouvement. Il devait savoir à 3 heures que Ney avait attaqué les Quatre-Bras à 1 heure. Les fautes du champ de bataille sont pardonnables, mais quand on a le temps de réfléchir, il est des fautes inexcusables. Wellington avait eu quatre heures de réflexion, lorsqu’après avoir connu l’attaque de Ney, il réunissait ses troupes aux Quatre-Bras. Il devait les réunir en arrière de Bruxelles, avant et après l’attaque de Fleurus. Il devait éviter tout combat jusqu’à l’arrivée des Alliés. Il a compromis le succès de la campagne trois fois. Il devait camper son armée, du moment que l’armée française était en mouvement, et la réunir sur une surface de trois lieues carrées. Les Anglais étaient battus sans Blücher. Bülow n’était rien. Son attaque avait échoué, et il était épuisé. Mais les deux autres corps qui sont arrivés, le soir, faisaient 35.000 hommes. Il n’y avait plus rien à faire.
La bataille de Waterloo ne peut être prête à présent pour remettre à L’av. ( ?). Il faut qu’il attende et qu’il trouve un prétexte pour rester. On lui payera son séjour à raison d’une livre par jour.
Conversation du 10 {avril).
Je n’ai jamais fait cas de Fouché et ne l’ai remis en place que parce que je n’y attachais aucune importance. Il a la figure d’un chat, est futé comme un chat, voilà tout. Il n’a jamais donné un conseil. C’est Fontanes qui l’a fait rentrer. Disgracié, il s’était aperçu que Fontanes avait des rapports avec moi et jugea apparemment qu’il pourrait s’en faire un intermédiaire. Fontanes dit effectivement un jour, à Saint-Germain, je crois, comme on parlait du Grand-Juge qui était un mauvais ministre, qu’on verrait avec plaisir que je rappelasse Fouché. Je le fis.
Talleyrand, Fouché, Cambacérès ont toujours été ligués contre toute idée de liberté. Ils craignaient bien plus l’opinion que moi qui n’en redoutais rien. Le peuple n’aime pas les voleurs en général. Ils craignaient les réactions de l’opinion publique.
Jamais je n’ai causé avec Fouché de ce que je comptais faire, de mes projets. Il n’en était pas de même avec Talleyrand, avec qui j’ai souvent causé de ce que je comptais faire quelques années après. On pouvait réellement causer avec Talleyrand, mais il était trop corrompu et sa femme également. C’est la vraie raison qui l’a fait éloigner des affaires. Je pense avoir eu tort : il m’eût été utile en quelques circonstances.
Cambacérès n’était pas républicain au fond. Comme avocat, il avait été domestiqué. Tant de gens dans Paris l’avait employé ainsi, qu’ils ne pouvaient avoir pour lui un grand respect. Lorsqu’il était appelé aux conseils d’administration, cela lui valait beaucoup d’argent. Il gagnait des 50, des 150.000 francs. Aussi avait-il une table d’un grand luxe. Cela dura 15 mois, et quand je m’en aperçus, je ne l’appelai plus aux conseils d’administration. Cambacérès fut obligé de mettre de l’ordre dans sa maison et de régler ses dépenses sur ses revenus fixes. Sieyès eût été meilleur deuxième consul, mais ce n’est pas à lui à qui j’ai pensé : il m’eût rappelé les principes de la Révolution ou plutôt les personnes de la Révolution. Cambacérès voulait toujours me jeter dans les gens de l’Ancien Régime. Lebrun avait des idées plus libérales. Il était homme de bien. Je l’appelais l’avocat du Tiers aux Etats de 1614, au lieu que Cambacérès était l’avocat des abus.
Mon grand tort à Châtillon : je devais faire la paix. Lorsque j’ai été battu à Dresde, je devais faire la paix. La fatalité s’en est mêlée. Il fallut céder aux circonstances. Deux ans après, j’aurais été maître de tout.
Murat m’a fait un grand mal.
1° A Dresde, il a servi à décider l’Autriche sachant qu’elle aurait 50.000 hommes de moins en Italie.
2° Au retour de l’île d’Elbe, par son attaque intempestive, il a fait croire à l’Autriche que je n’étais pas de bonne foi, qu’il n’y avait rien à faire avec moi. S’il m’eût envoyé un million à l’île d’Elbe, cela eût procuré quelques douceurs, eût mis à l’aise pour quelques dépenses.
L’affaire de Mme Walewska m’a fait grand mal. C’est la goutte d’eau qui fait verser le verre. J’ai trouvé cela si bas : lui si flatteur pour elle, tel qu’il était à Finkenstein ou Schönbrunn, lui refuser une dotation et venir ensuite lui offrir tout, sitôt qu’il sût mon débarquement ! Ce dernier tort, l’impression qu’il me fit fut réellement ce qui m’empêcha de le faire venir à Waterloo. Ça peut-être été un grand malheur. Si Murat eût été là, peut-être la cavalerie, conduite autrement, eût-elle décidé de la victoire.
J’ai fait une faute de faire Junot gouverneur de Paris. Il n’était rien pour la Cour et il ne pouvait rien être pour le Faubourg Saint-Germain : il était trop nouveau. Il voulait avoir des pages, une escorte, et s’en prenait à moi de ce que la charge ne fût pas ainsi. Il avait tort, mais c’est moi qui avais eu le premier tort de le faire Gouverneur; cela n’était bon à rien.
Murat étant grand amiral voulait influer sur la marine. Il ne comprenait pas que je ne voulais faire de cela qu’un titre. En général il y a des charges qu’on ne peut ressusciter et il faut en laisser dormir la mort. La place de Grand Electeur n’a eu aucun inconvénient, parce que, comme il n’y en avait jamais eu, personne ne pouvait fonder de prétentions sur le passé.
Il ne fallait à Naples qu’un vice-roi et non un roi. Cela n’aurait eu que des avantages. D’abord un vice-roi qui savait que son autorité était précaire ne m’eût pas constamment tourmenté. Il se fût conduit comme Eugène. Qui sait comment Eugène lui-même se fût conduit s’il eût été roi au lieu de vice-roi ? J’aurais eu près de moi un secrétaire d’Etat de Naples, j’aurais fait moi-même le budget. C’est une grosse affaire pour une nation qu’un budget, que des paiements précis. La dépense du roi qui était énorme n’eût été plus rien et tous les fonds eussent été utilement employés (…). Dans le fond, il importait peu à l’Autriche, que je fisse le prince Eugène ou quelqu’autre roi d’Italie. Metternich disait: « Nous avons notre expérience : les princes de notre Maison sont nos plus grands ennemis. » Les électeurs de Trêves, de Cologne, ont toujours été les alliés de la France. Les princes de la famille d’un Souverain ne se croient réellement indépendants que lorsqu’ils ont fait un traité d’alliance contre le souverain de leur Maison. A leur premier traité, ils se croient réellement indépendants.
Jérôme a porté en Allemagne le luxe et les débordements de la Cour de Westphalie. Il y fallait un gouvernement simple. J’ai fait là une nouvelle faute. Il fallait fortifier le roi de Saxe comme puissance, conséquemment lui donner la Silésie et le Grand-Duché de Varsovie.
Je voulais que son successeur fût roi d’Italie avec le prince Eugène comme régent. C’est pour cela que je lui avais donné une grosse fortune. Il eût été prince d’Italie. Si je l’avais fait roi, ç’eût été une semence de guerre dans ma famille. Mes enfants eussent regardé le Royaume d’Italie comme leur patrimoine et le prince Eugène eût été forcé, pour le conserver, de se lier avec l’Autriche.