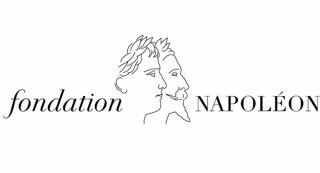Monuments des Victoires et Conquêtes – Saint-Bernard

Saint-Bernard – David |
L’Histoire doit consacrer à l’honneur de la gloire française un des évènements la plus extraordinaire qui puissent enrichir ses annales, c’est le passage en Italie de l’armée de réserve formée à Dijon, la première année du consulat de Bonaparte, le 17 mai 1800. Le mont Saint-Bernard, le Simplon, le mont Cenis, le Saint-Gothard, le petit Saint-Bernard furent franchis en même temps avec la même rapidité, malgré les obstacles presque invincibles qu’opposaient au courage des Français, les torrens, les fondrières, les précipices, l’escarpement des rochers, les glaces éternelles qui les couvrent, les neiges et les avalanches qui menaçaient de les engloutir. Les canons encaissés dans des troncs d’arbres creusés, leurs affûts démontés, toutes les munitions nécessaires furent portés et traînés à bras d’hommes sur ces monts inaccessibles, et la pente rapide qui regarde l’Italie fut franchie par toute l’armée par les moyens dont les Français ont seuls donné l’exemple.
C’est au sommet du mont Saint-Bernard, sur un cheval blanc qu’un vent impétueux fait se cabrer, que David a peint Bonaparte : il précède ses troupes auxquelles il indique d’une main l’Italie, de l’autre il cherche à guider son coursier dont il tient la bride. Un ample manteau rouge [1] qu’il porte, gonflé par la bise, et entr’ouvert, laisse apercevoir l’habit du général, son écharpe éclatante et son sabre ; sa jambe presse le flanc du coursier, comme pour le forcer à franchie un précipice. On aperçoit dans une ravine les têtes, les armes et les drapeaux des troupes qui gravissent le mont. Sur des quartiers de rochers placés au-devant du tableau, on lit les noms d’Annibal et de Charlemagne ; l’artiste y a ajouté celui de Bonaparte, rapprochement ingénieux dont l’audace et l’intrépidité de ce dernier confirment la justesse. Ce portrait, fièrement dessiné, est d’une ressemblance tout-à-fait historique [2][2] ; il est savamment colorié ; en un mot, il nous semble digne de l’époque dont il transmet le souvenir à la postérité (L. V.) |
[3] Cette précision laisse entendre que l’artiste s’est inspiré de la version de février 1801 (n° 2 dans l’étude présentée sur ce site)
[4] On sait qu’en fait Bonaparte passa le col sur le dos d’une mule !